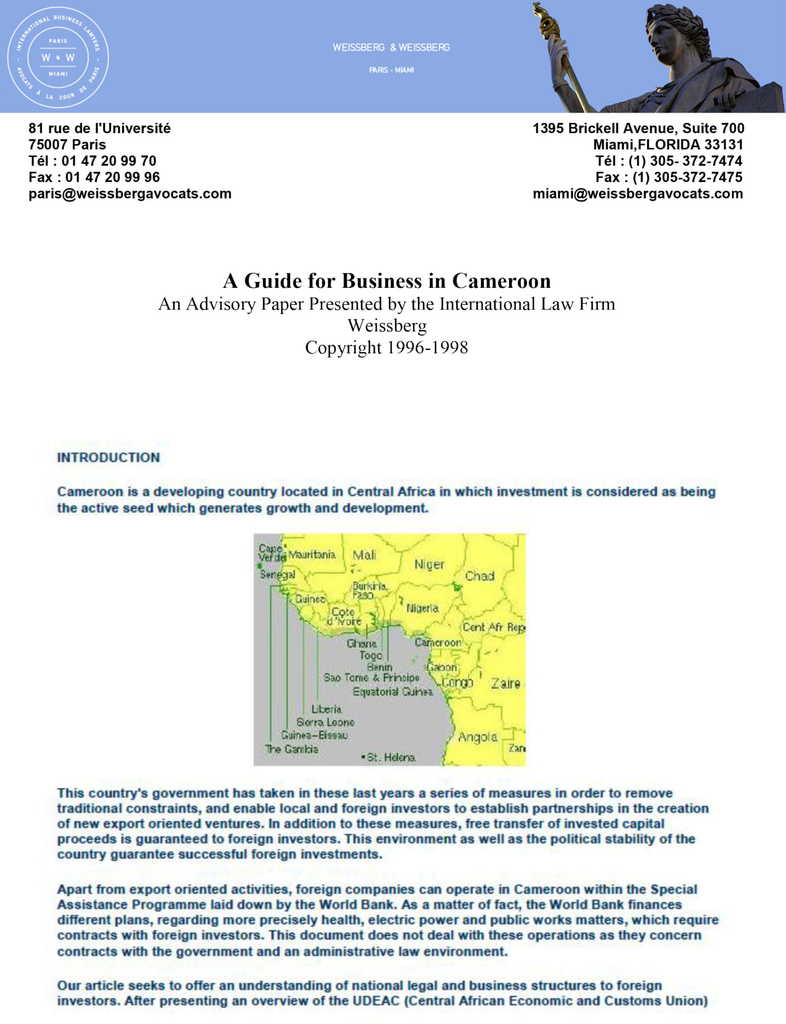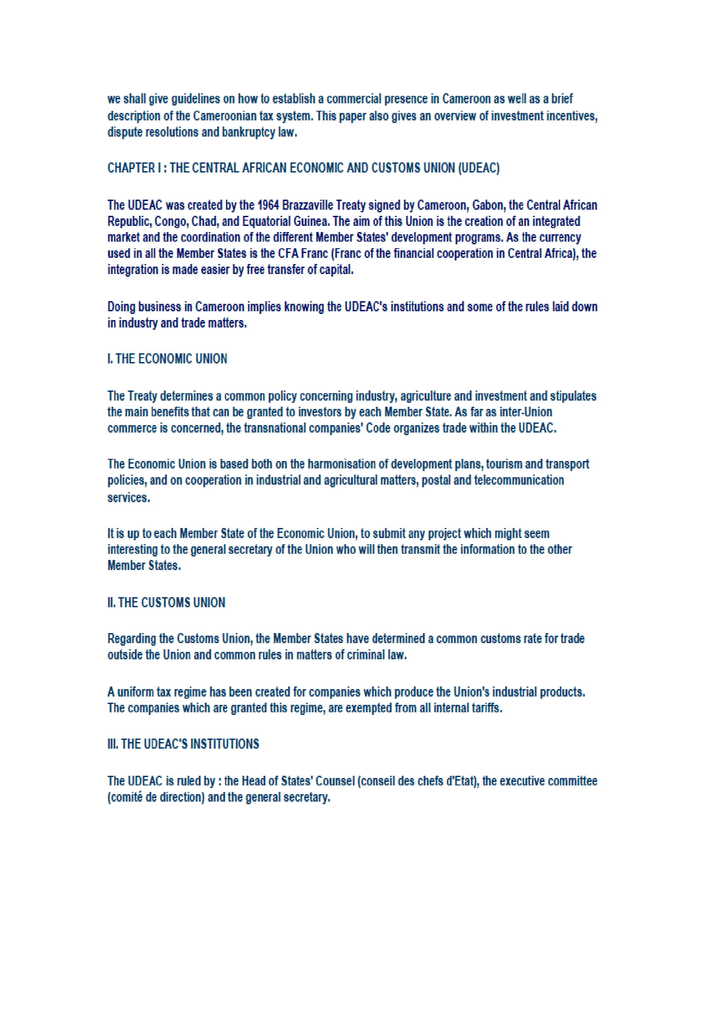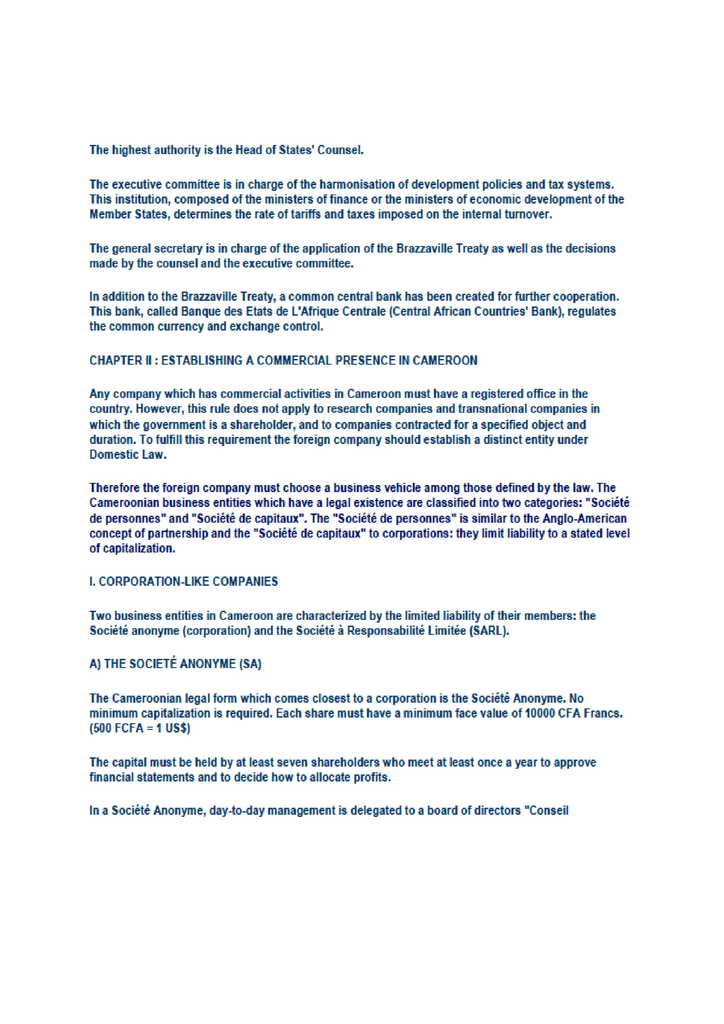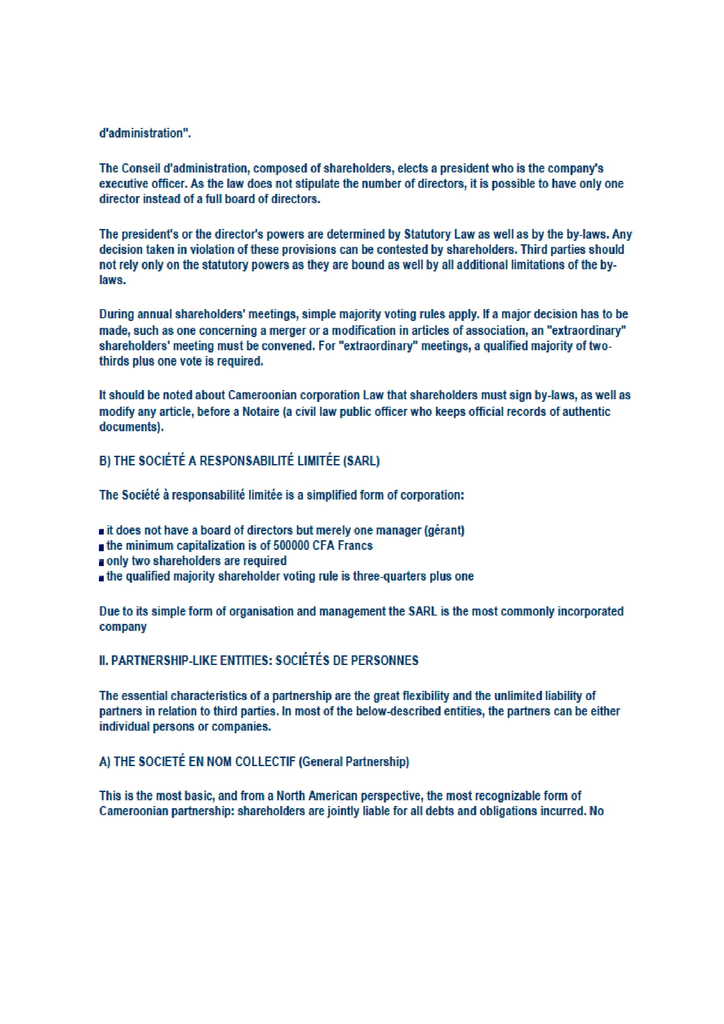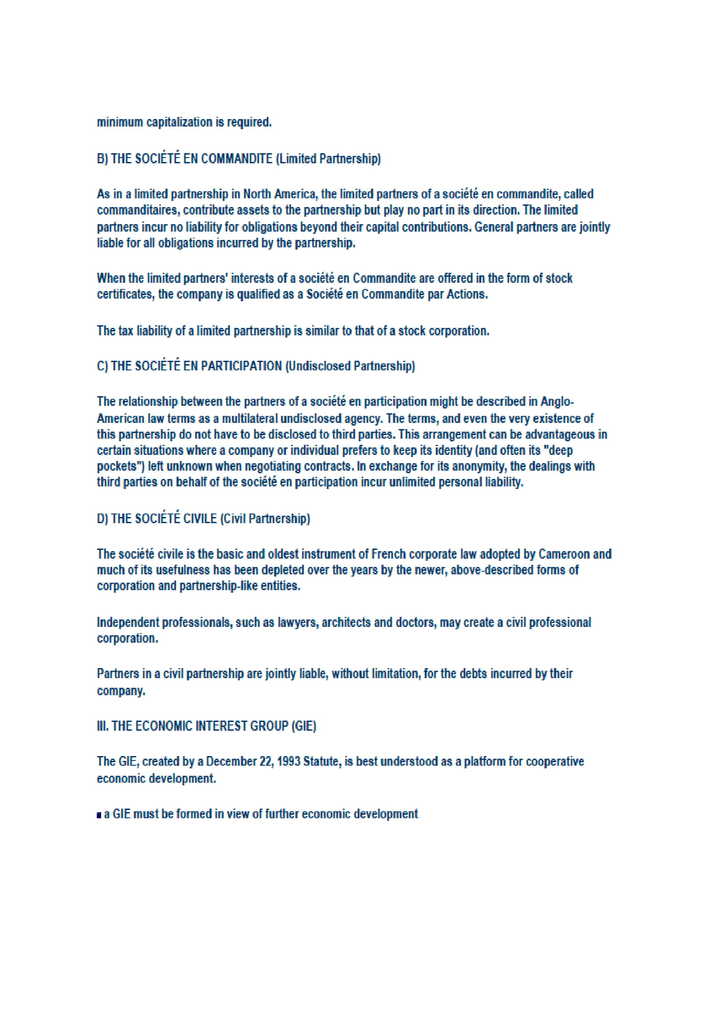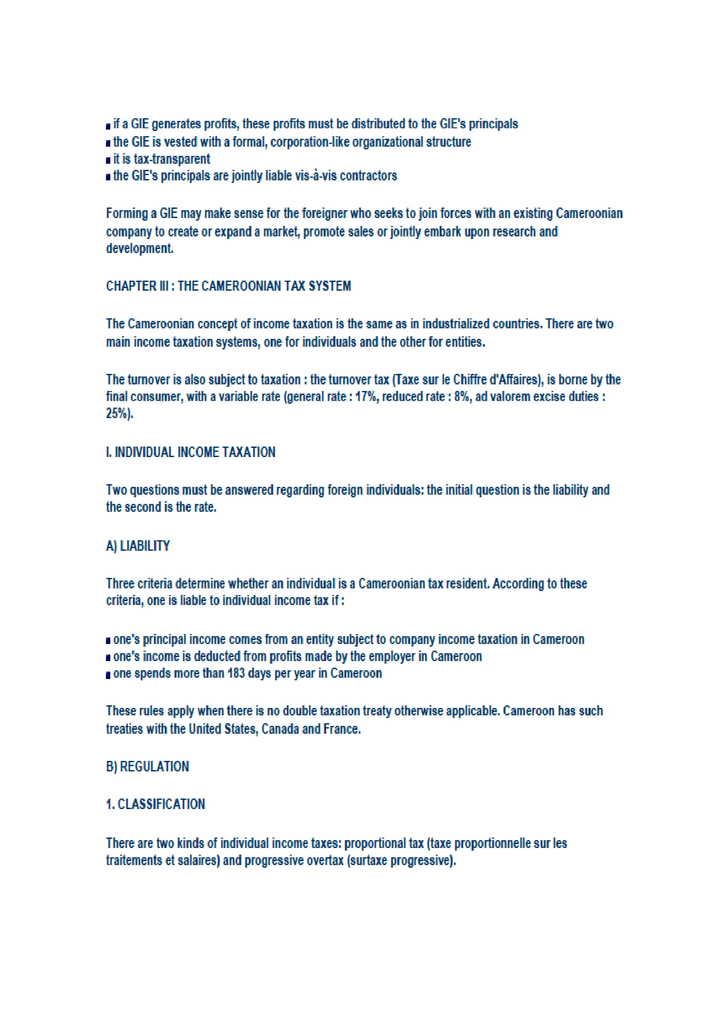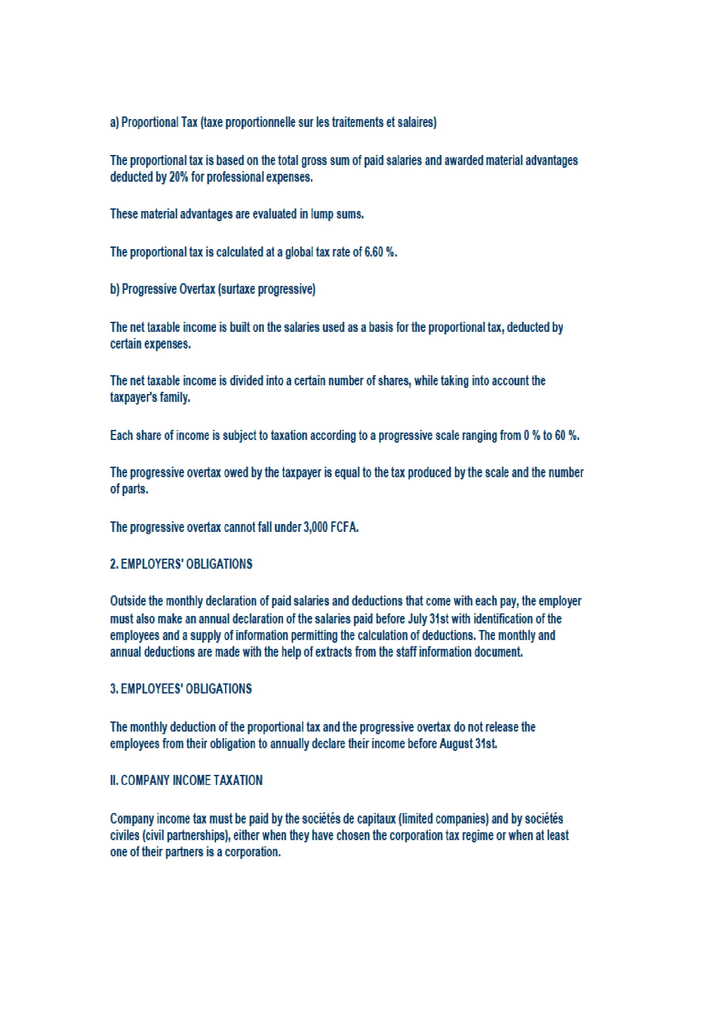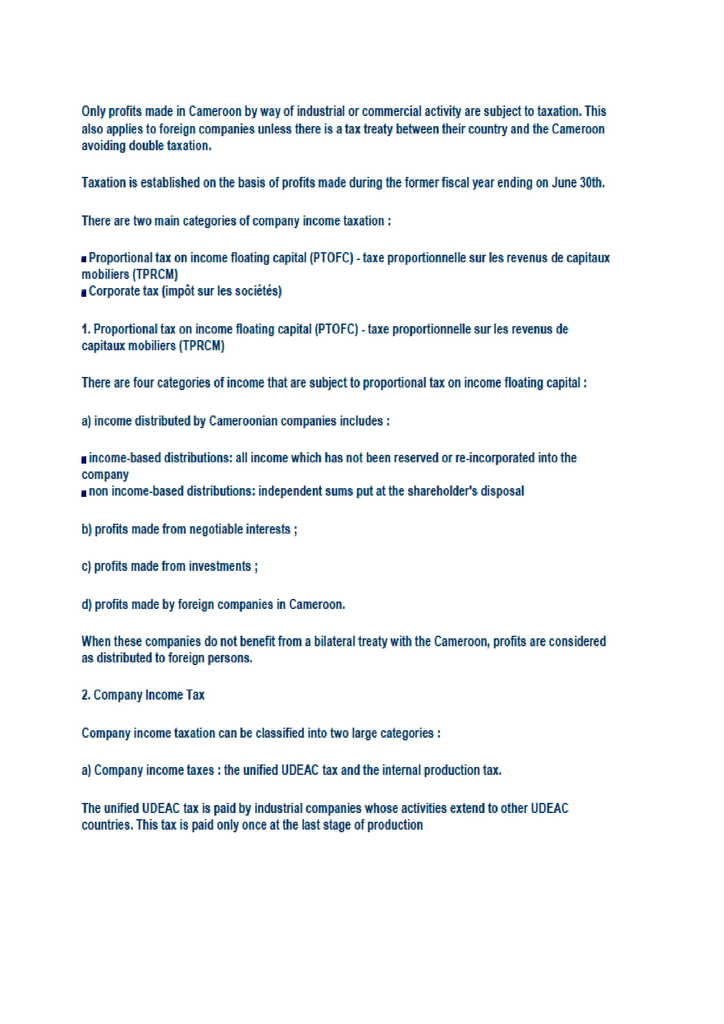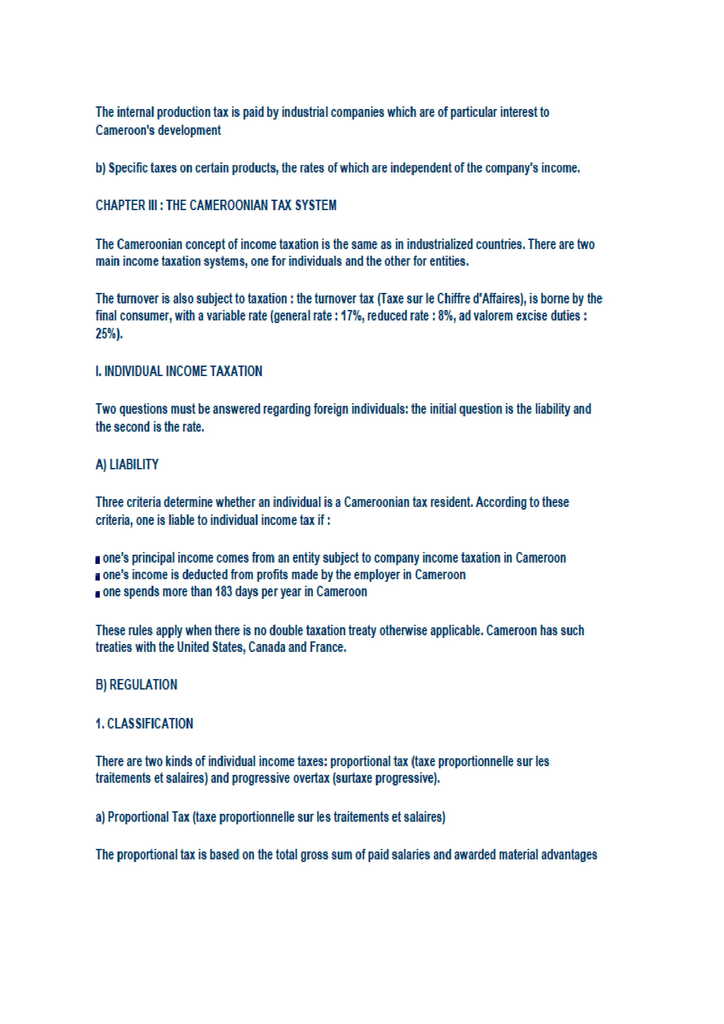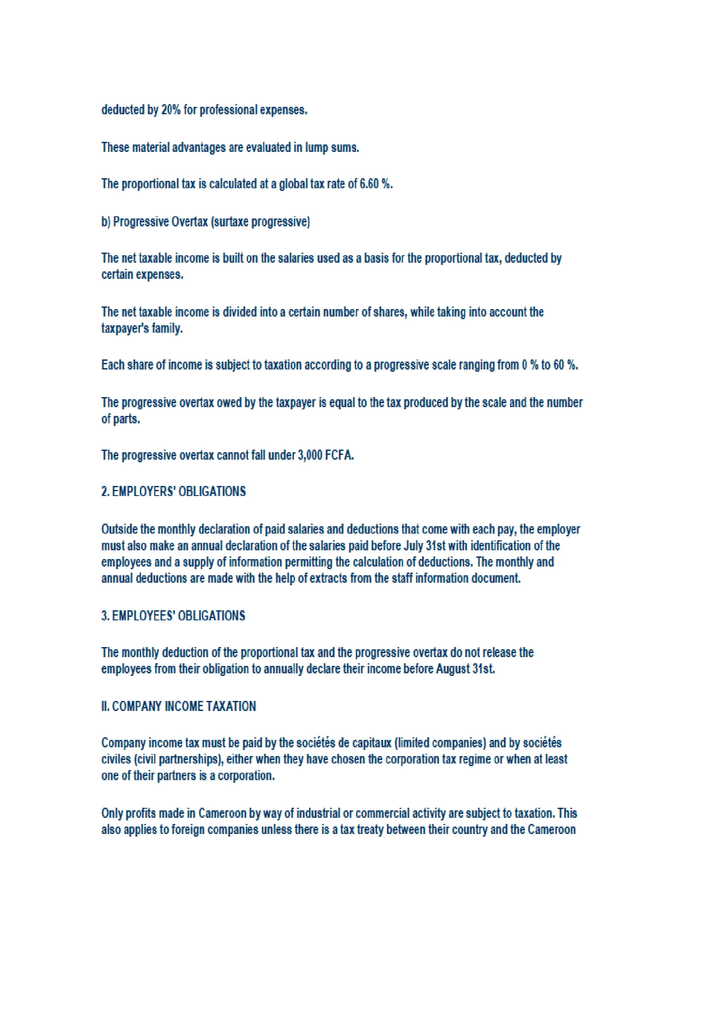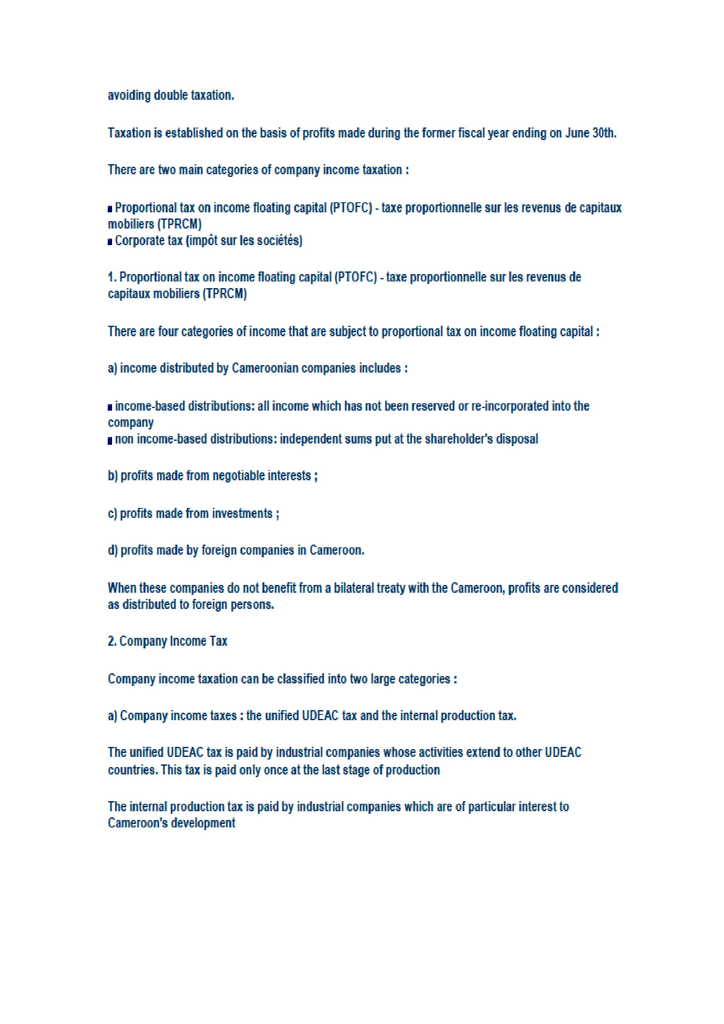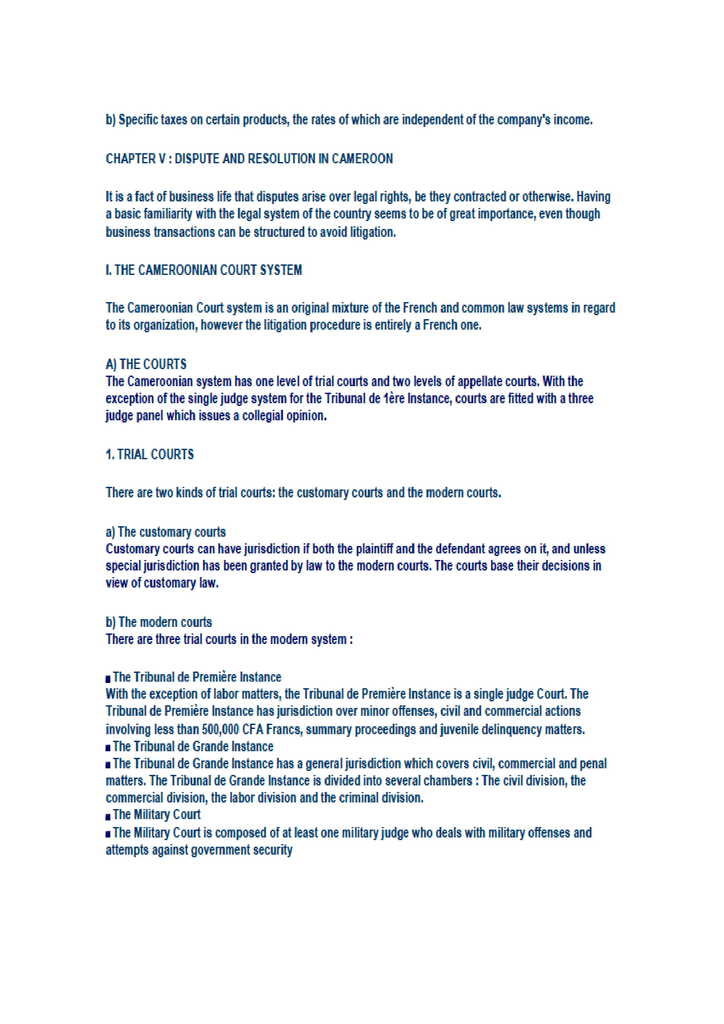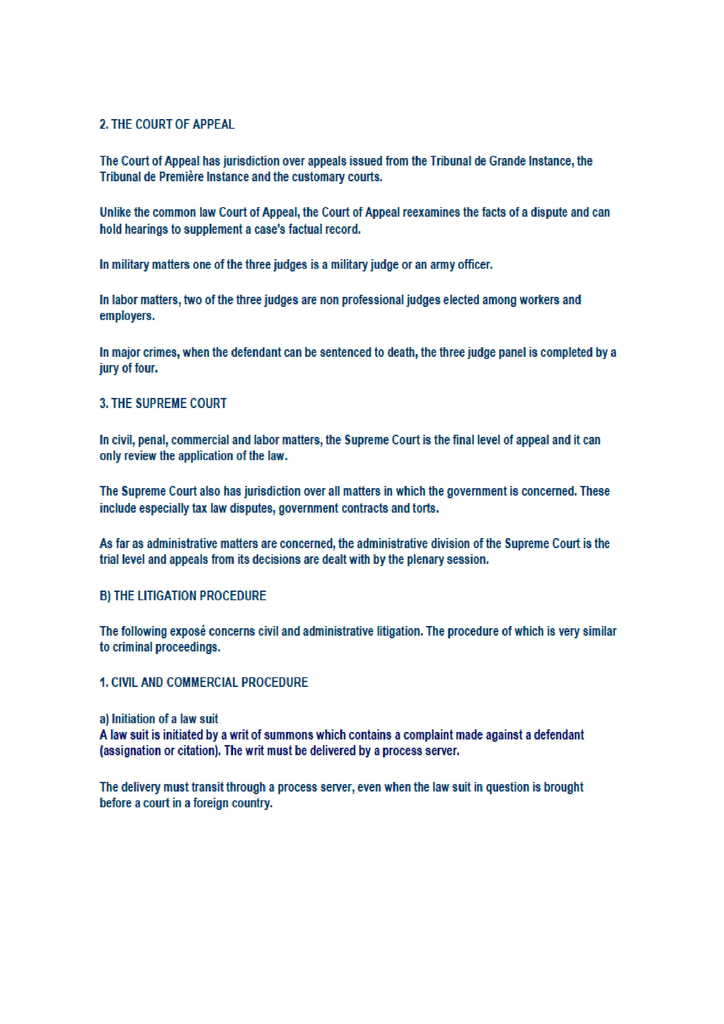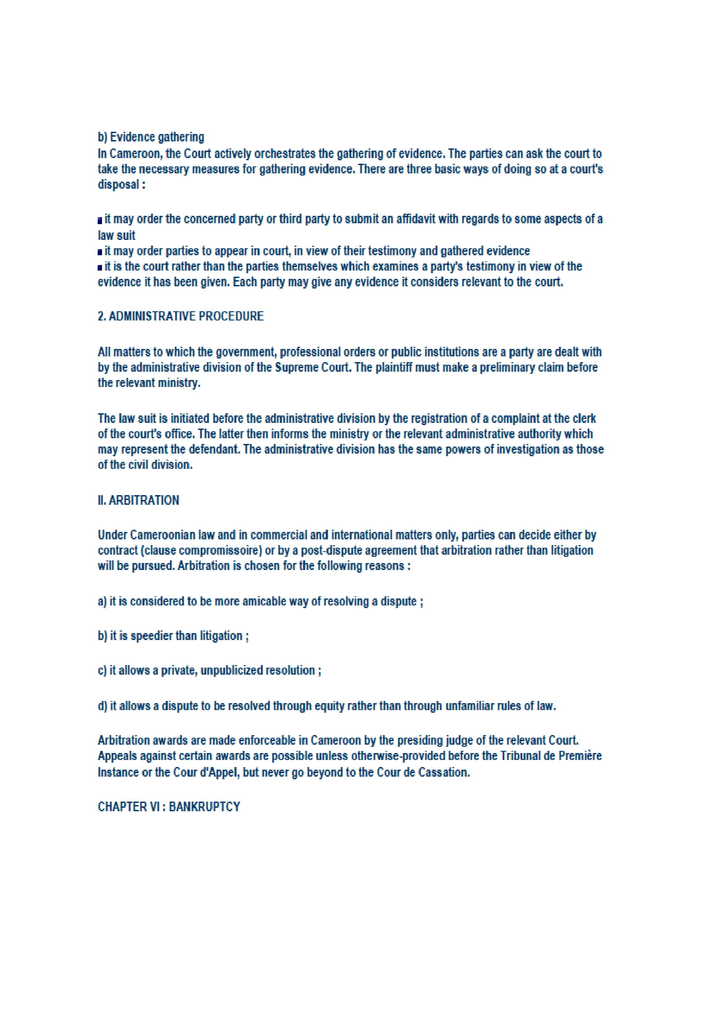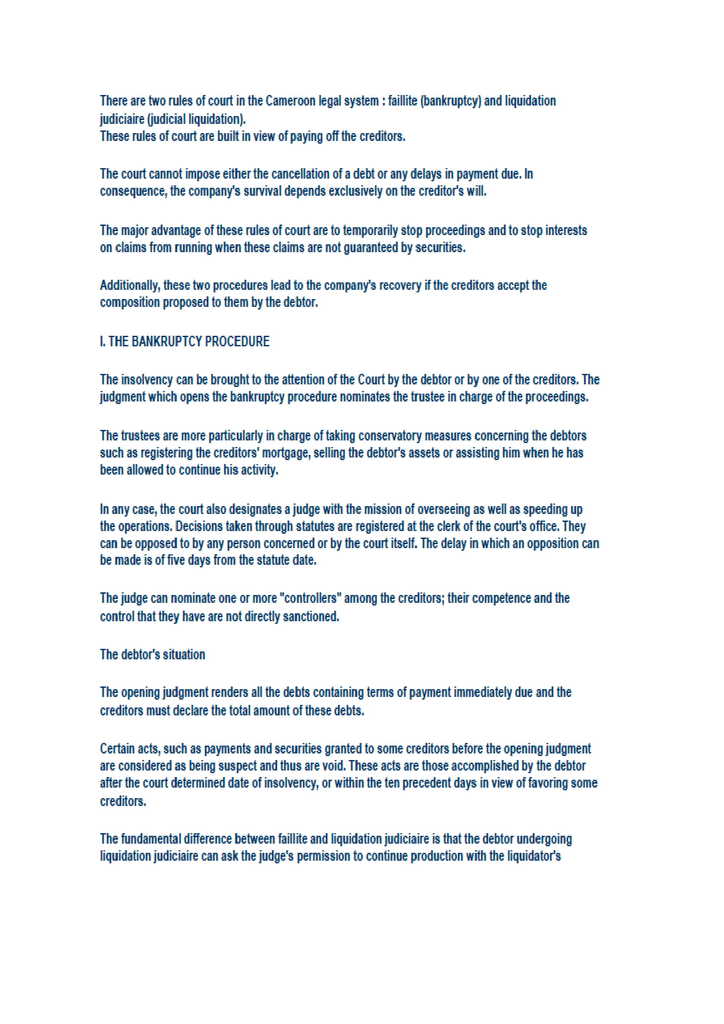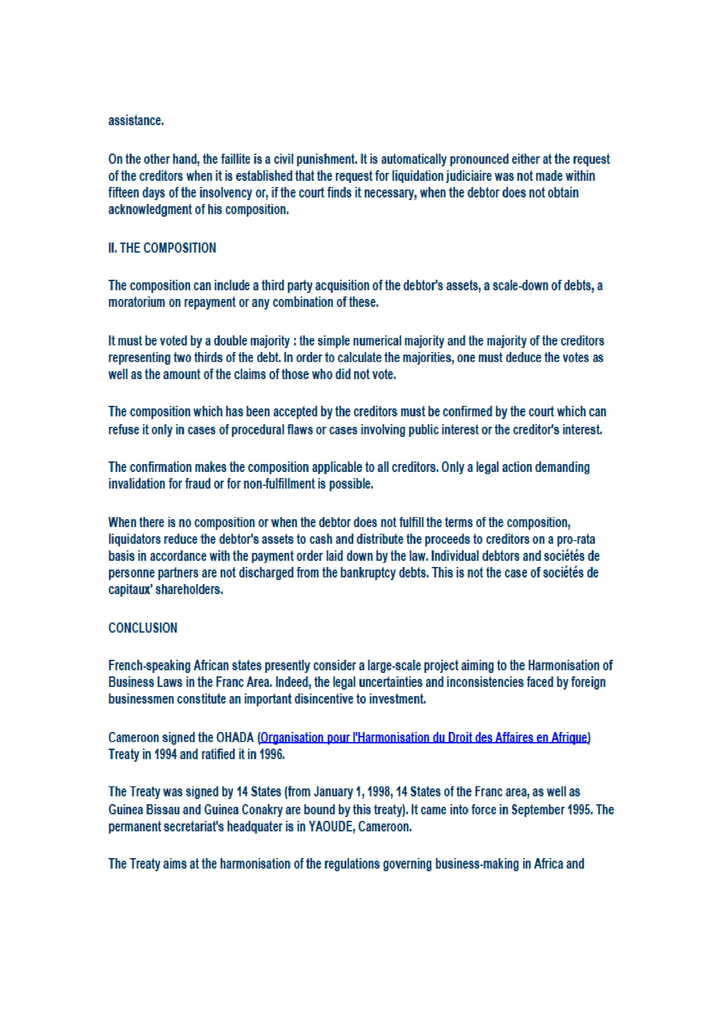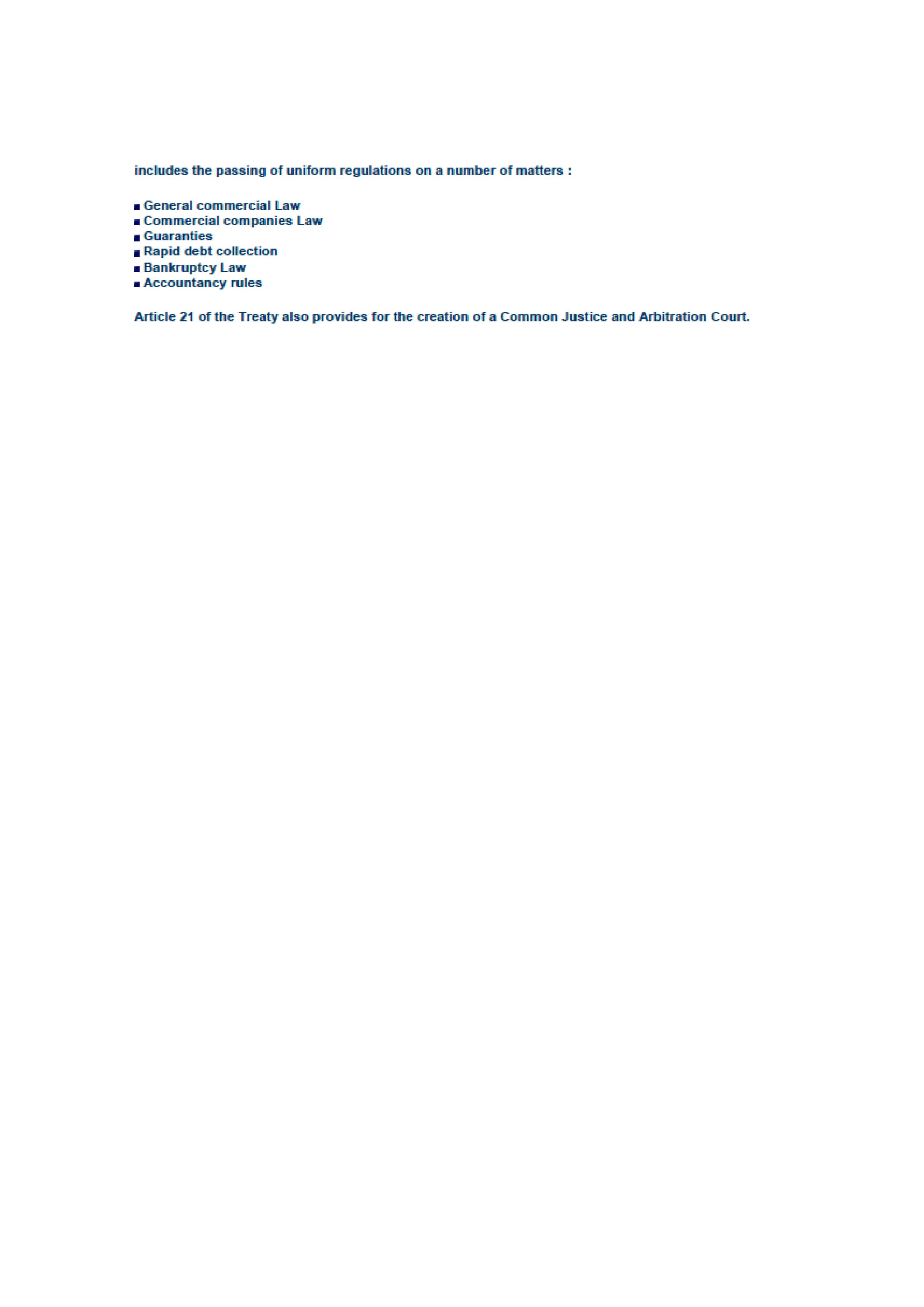Aspects juridiques de l’implantation d’entreprises françaises à l’étranger : l’exemple des Etats-Unis (Fr)
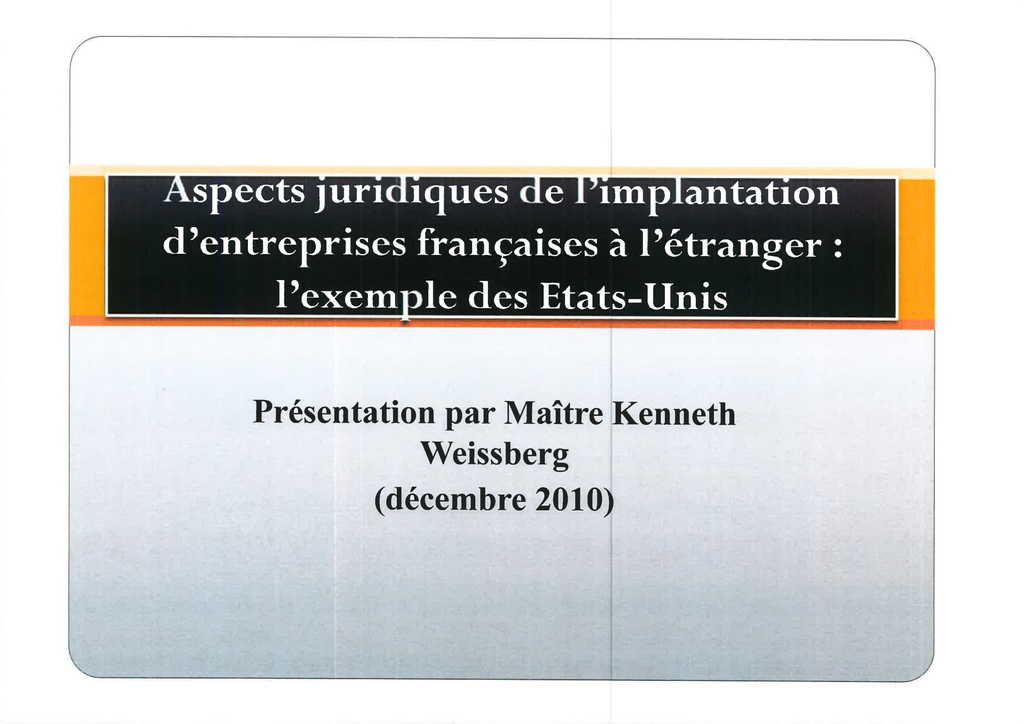
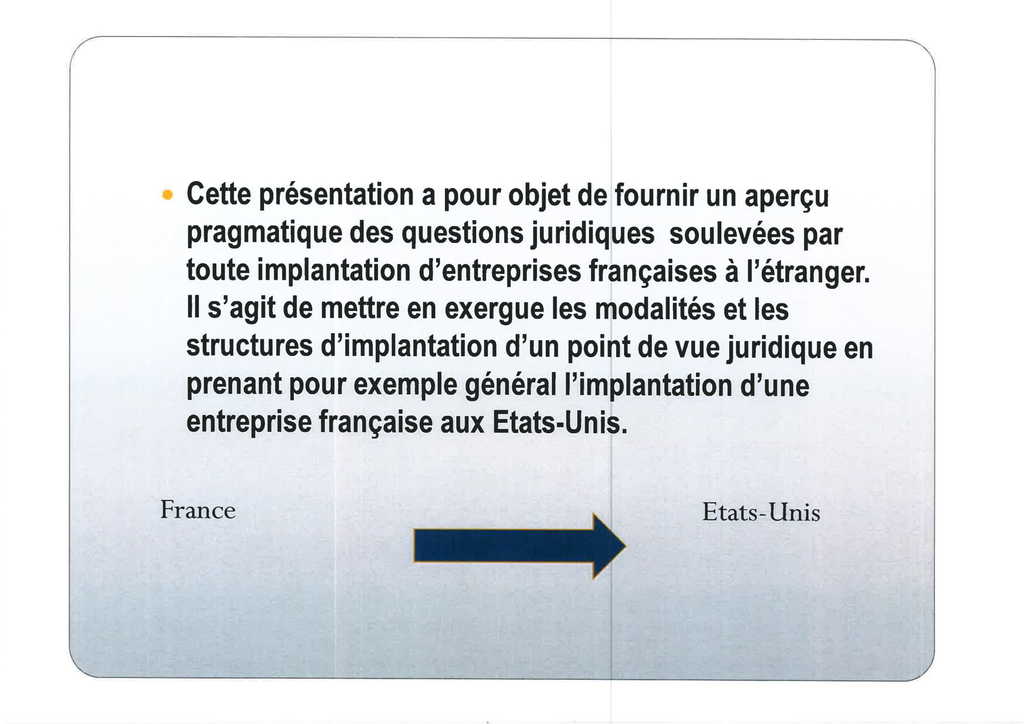
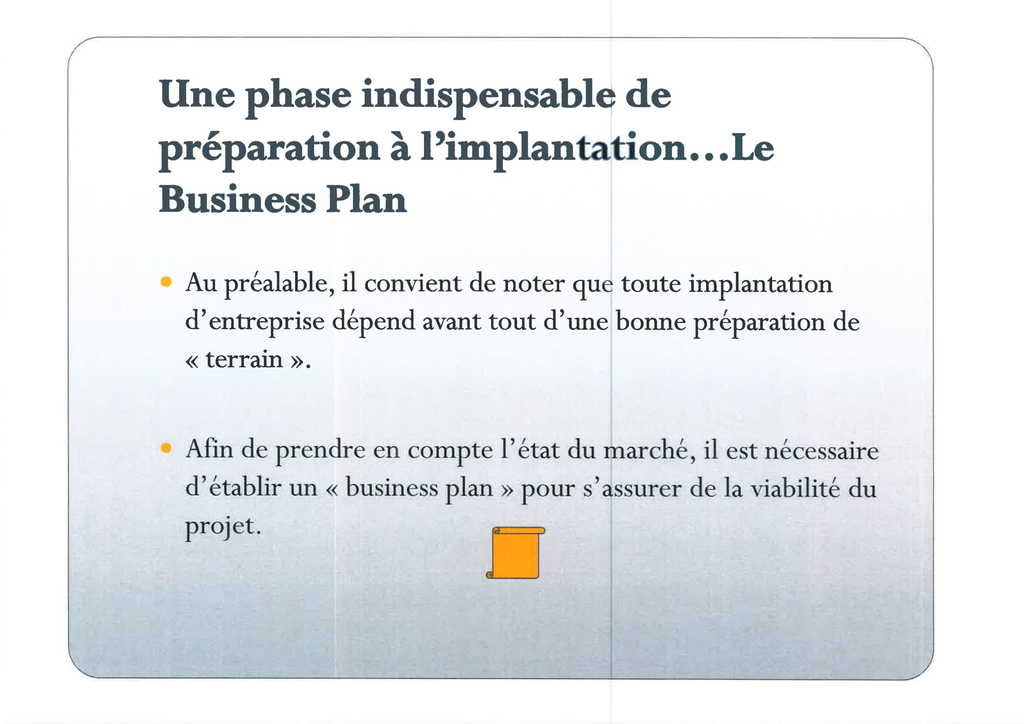
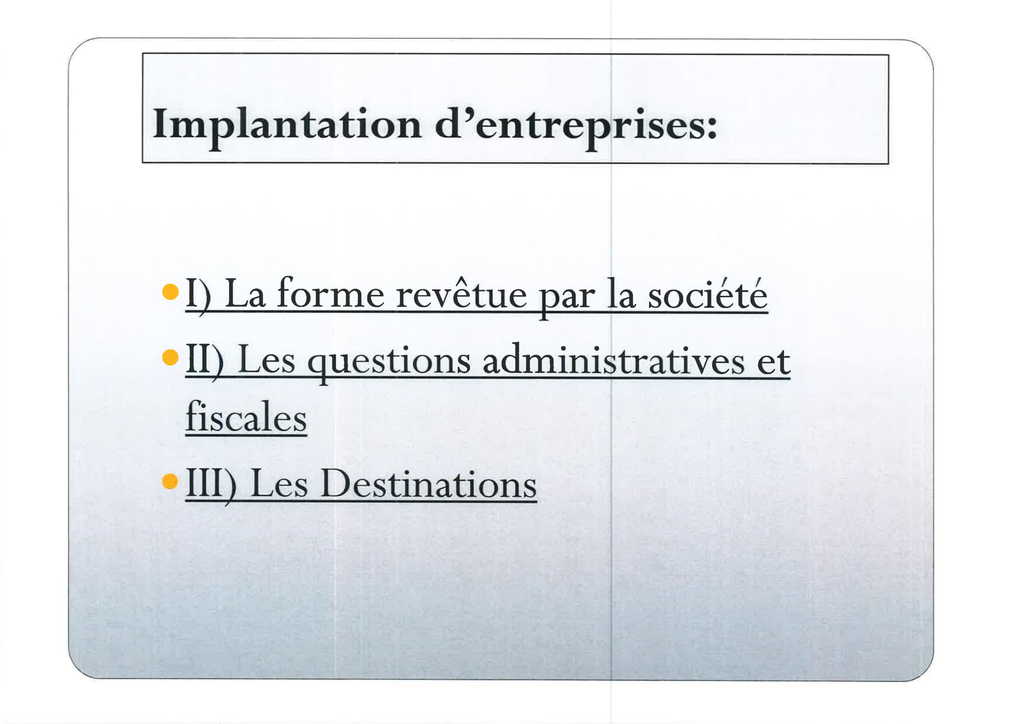
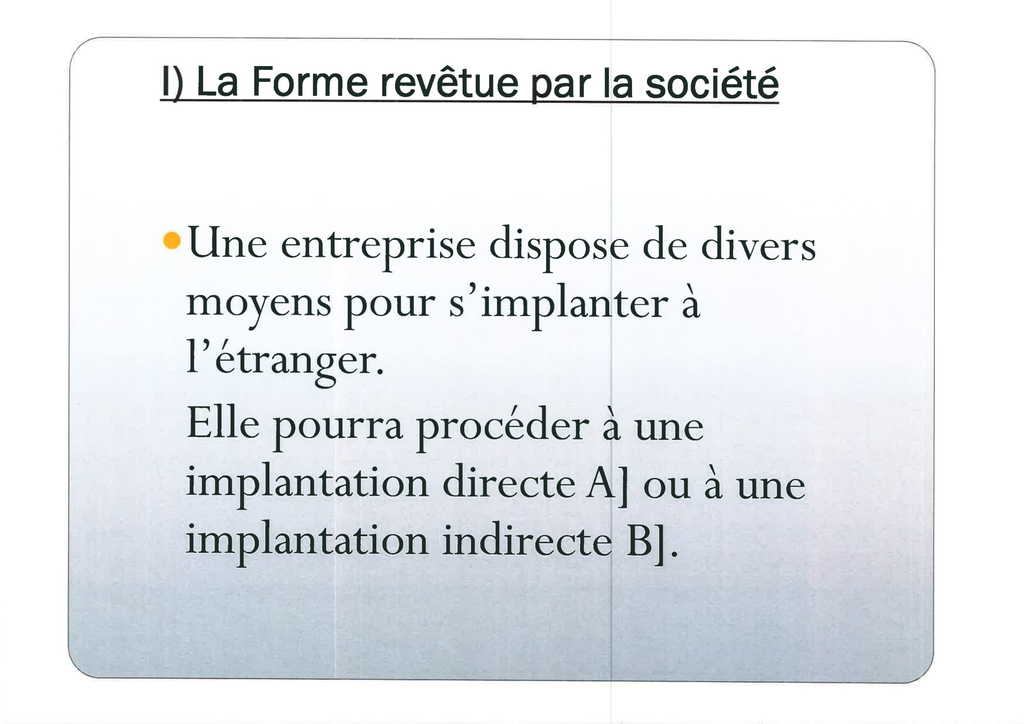
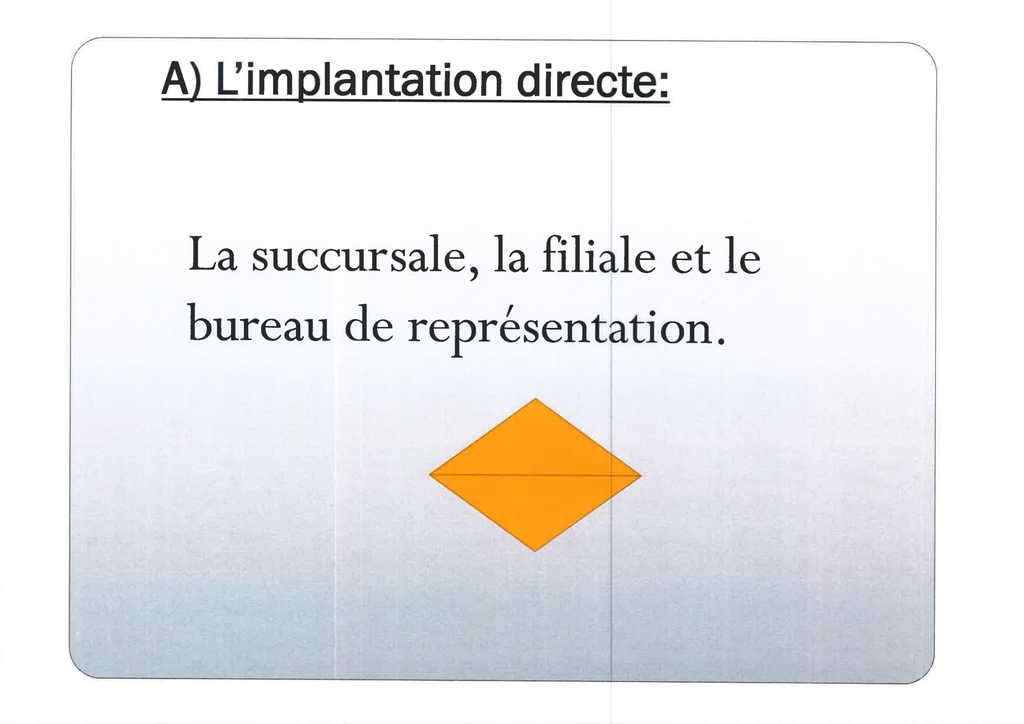
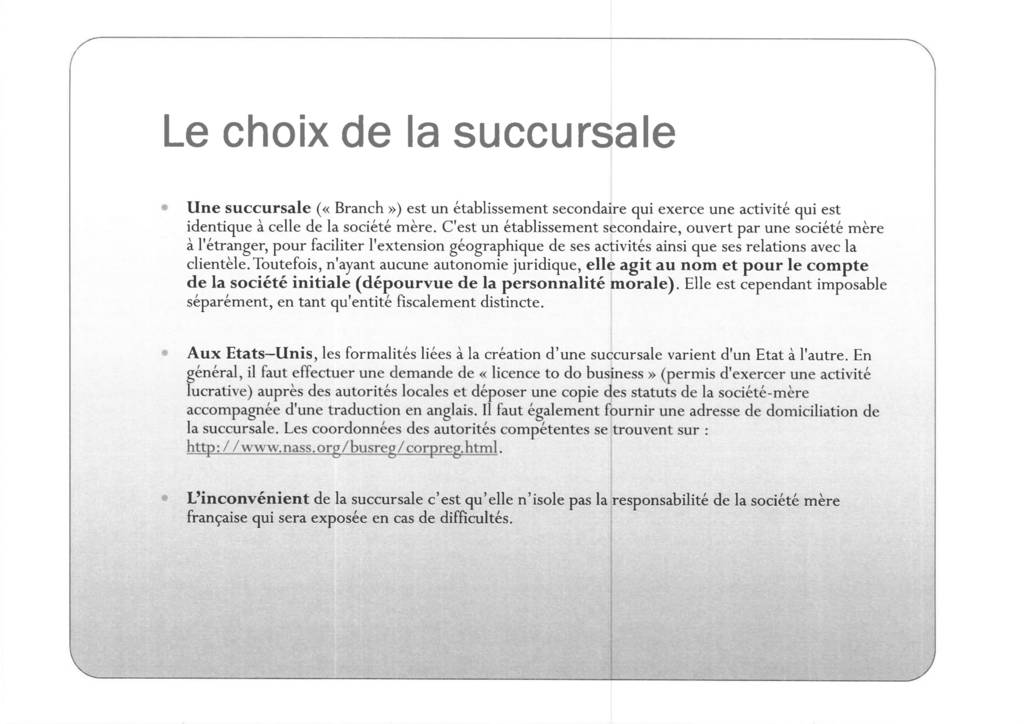
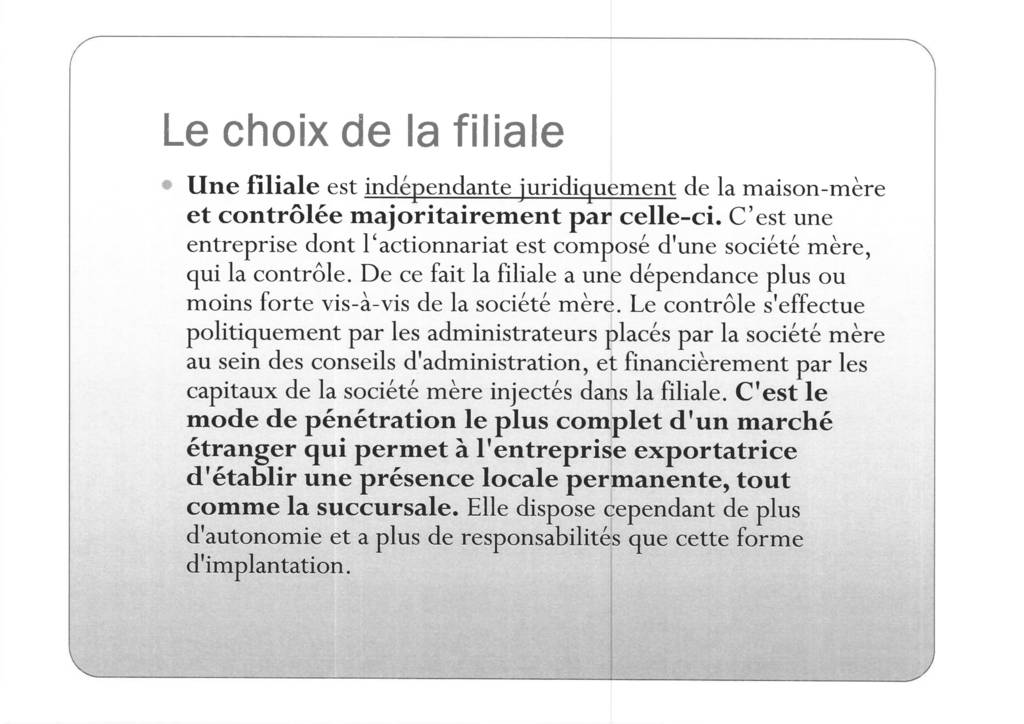
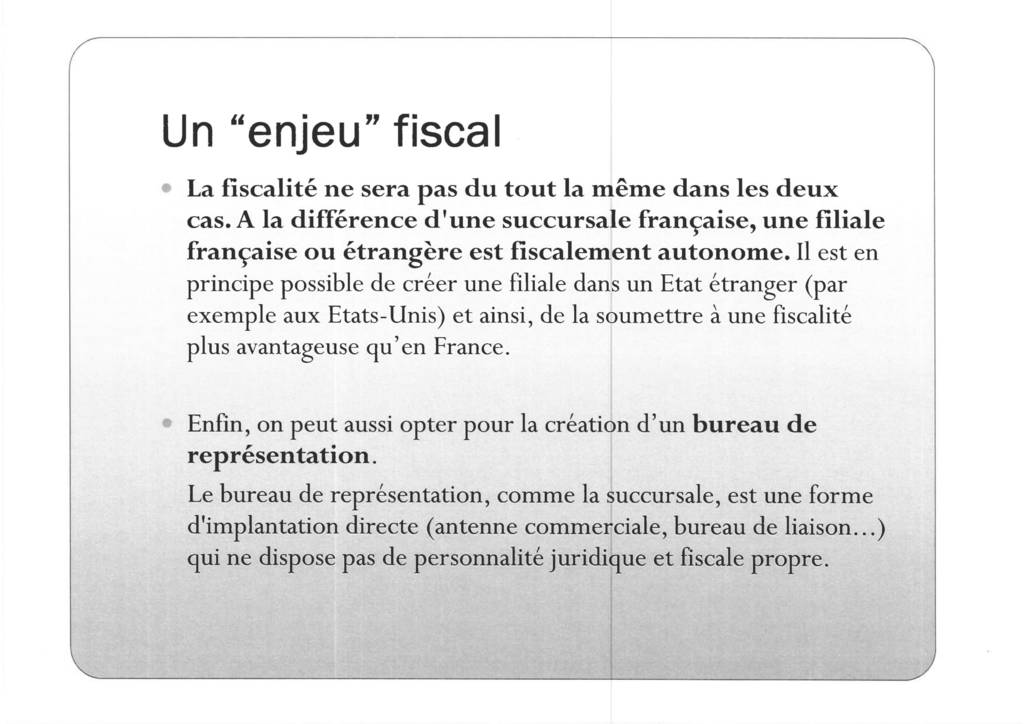
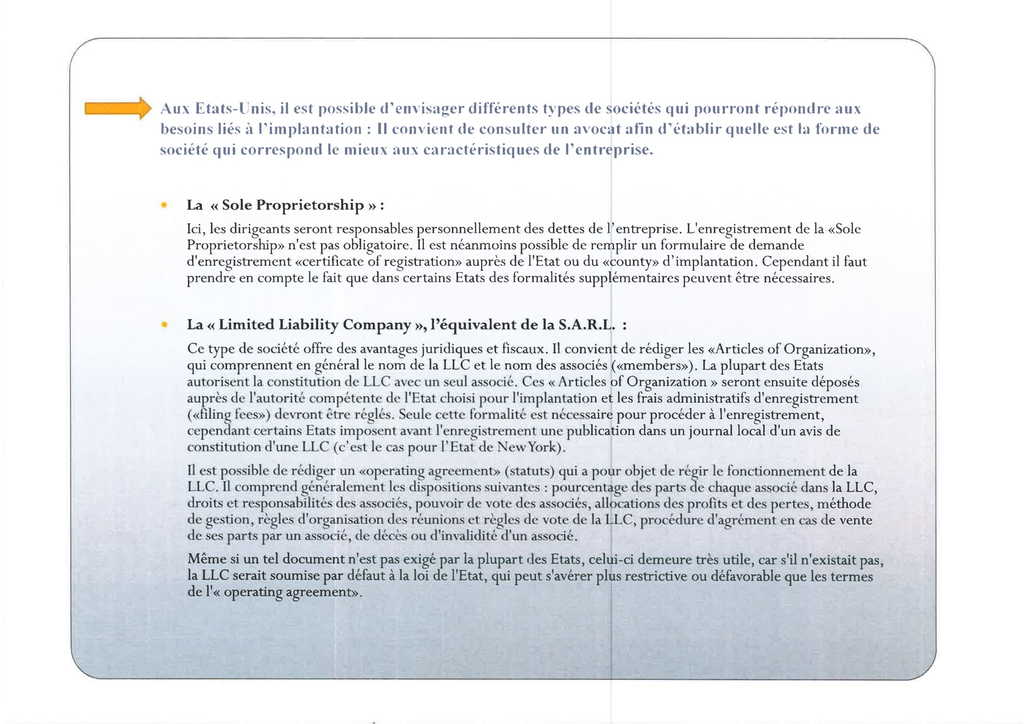
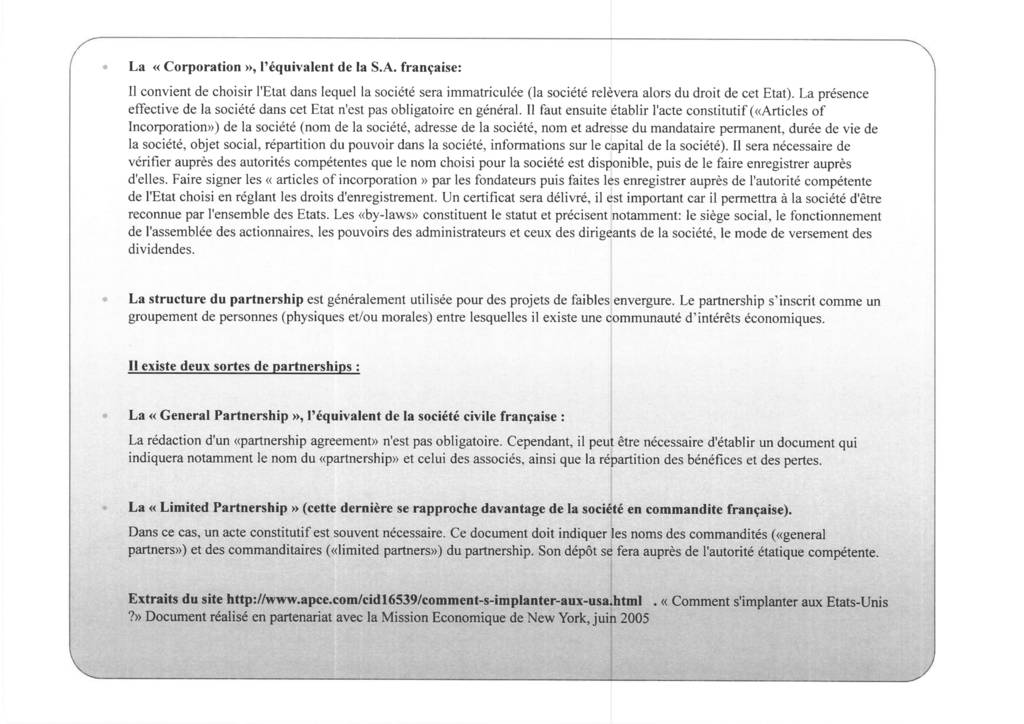
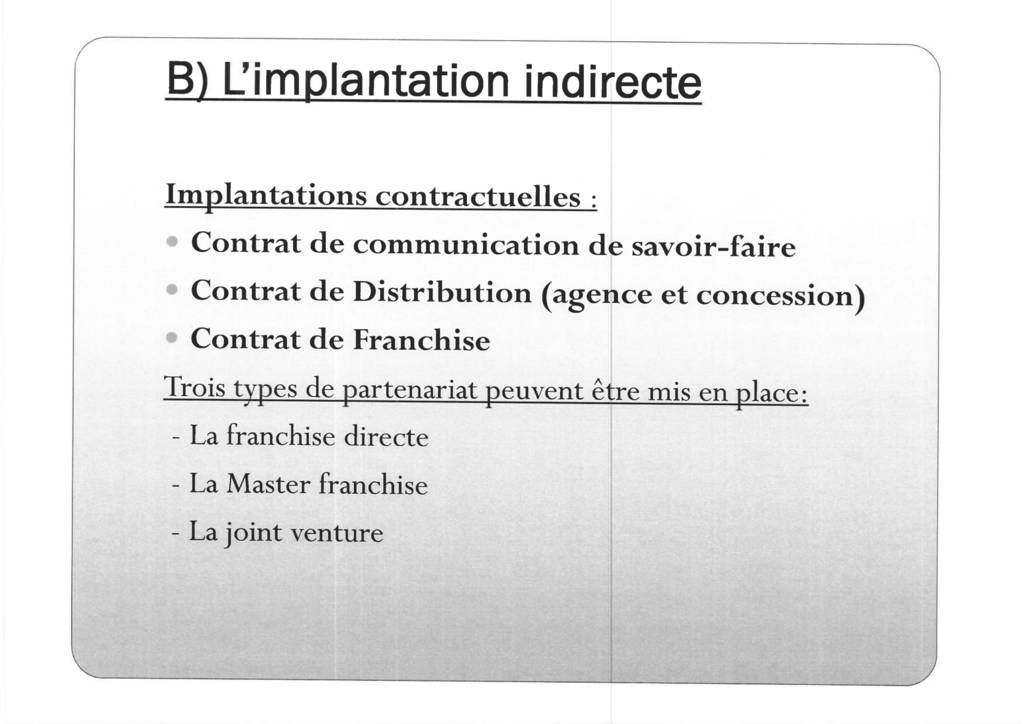
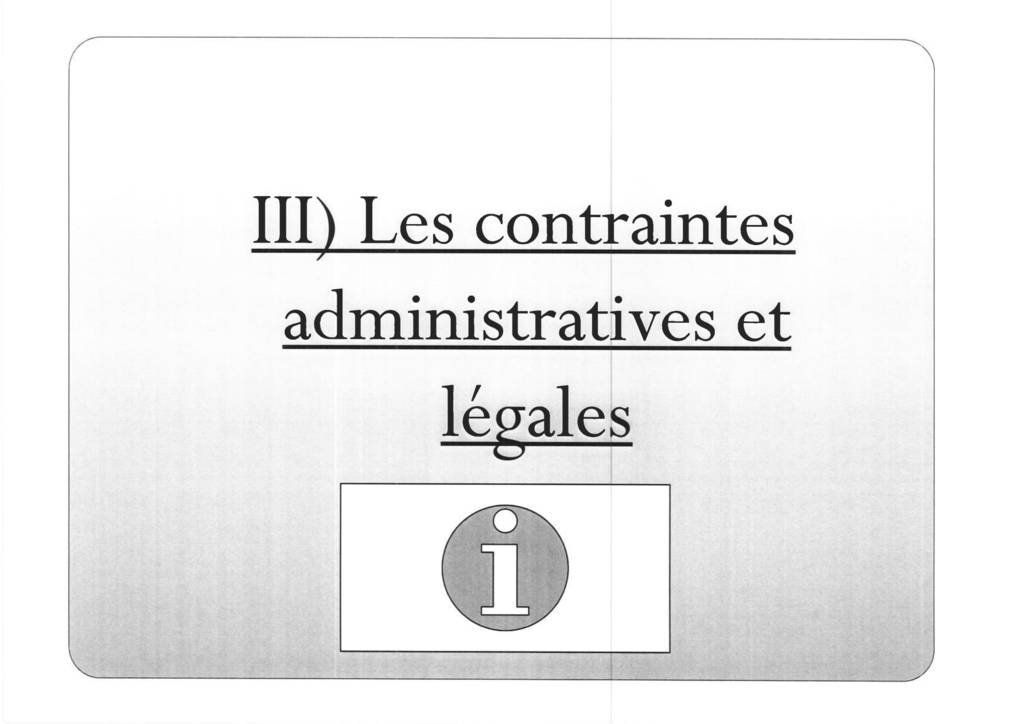
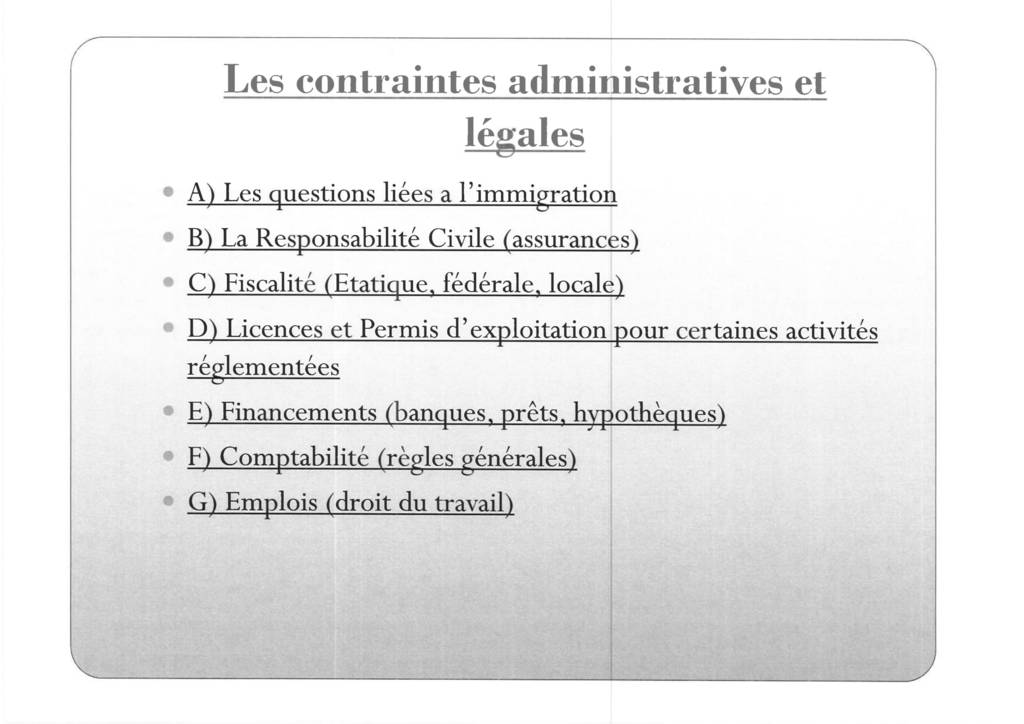
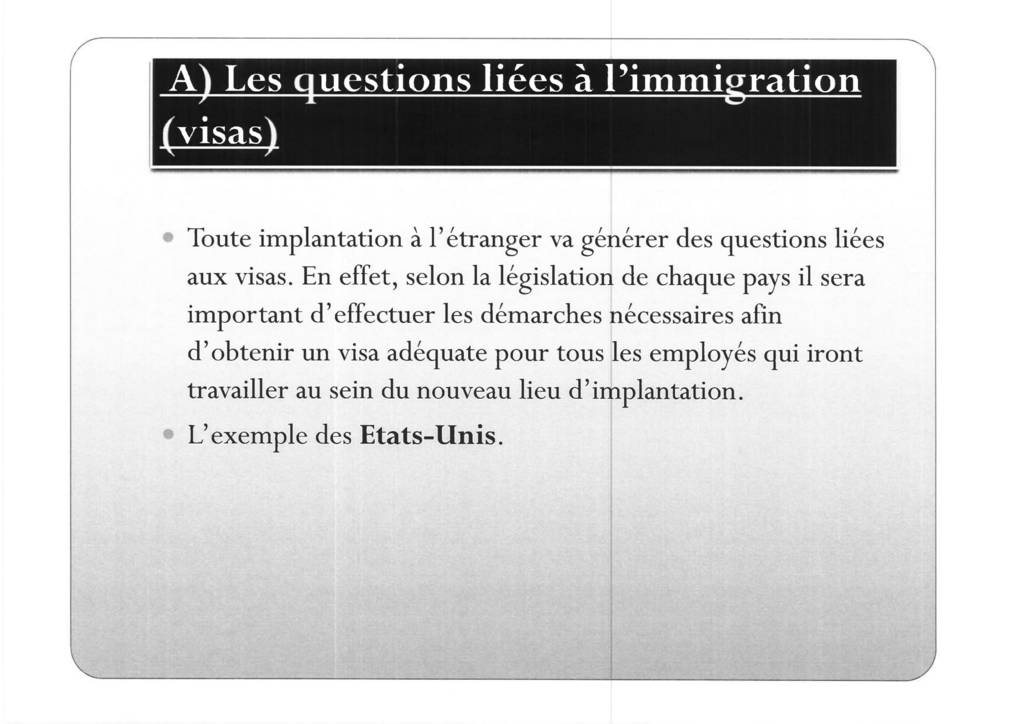
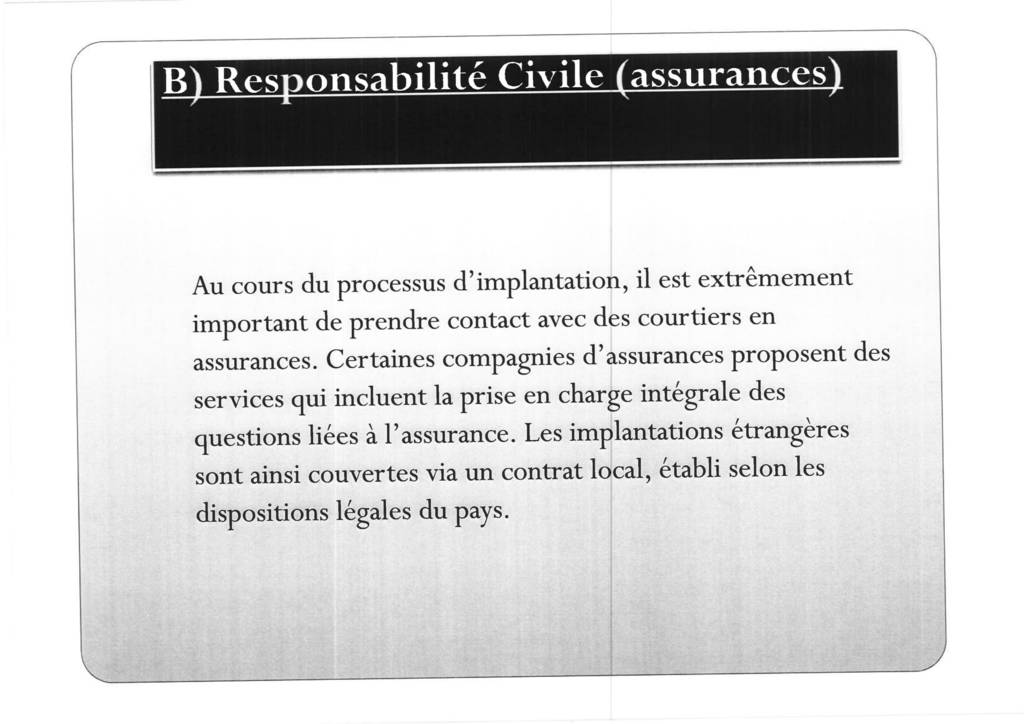
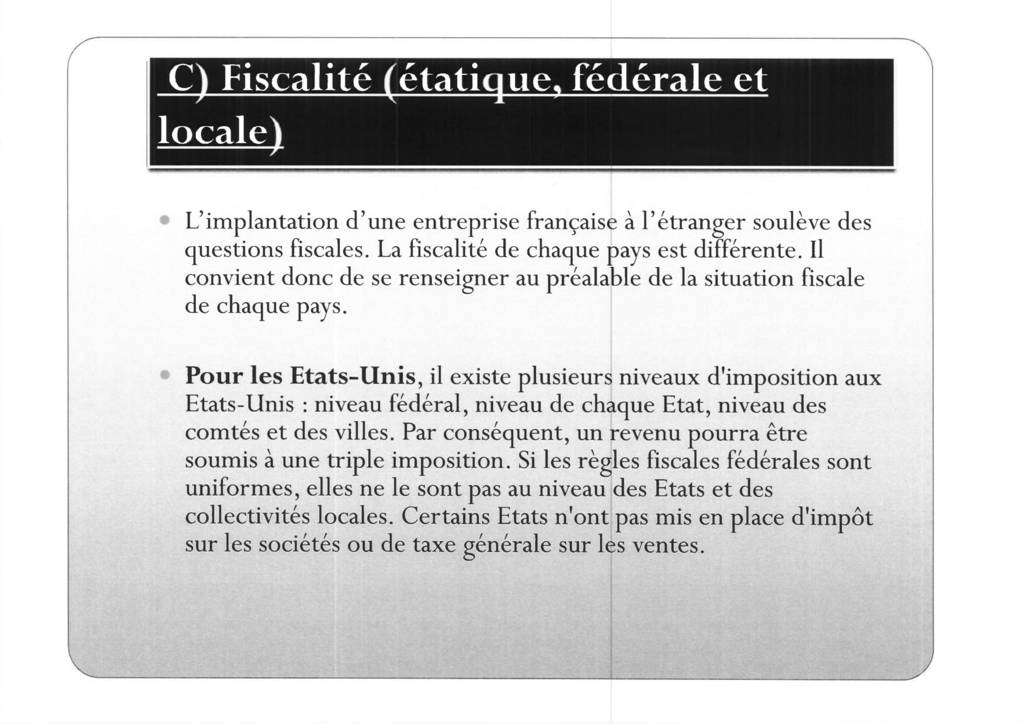
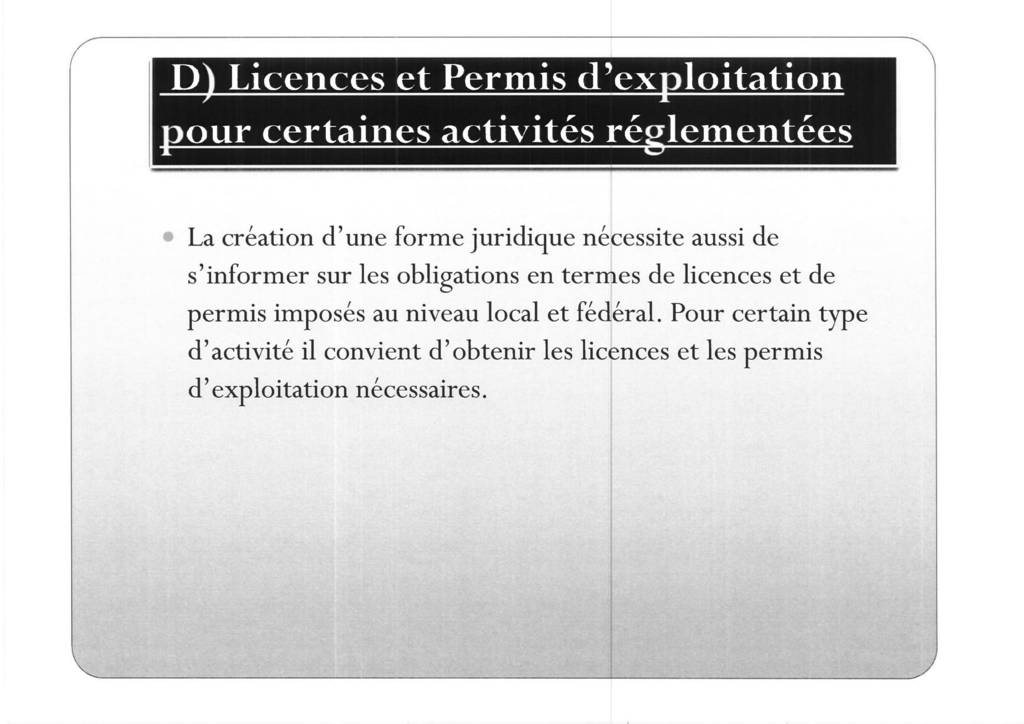
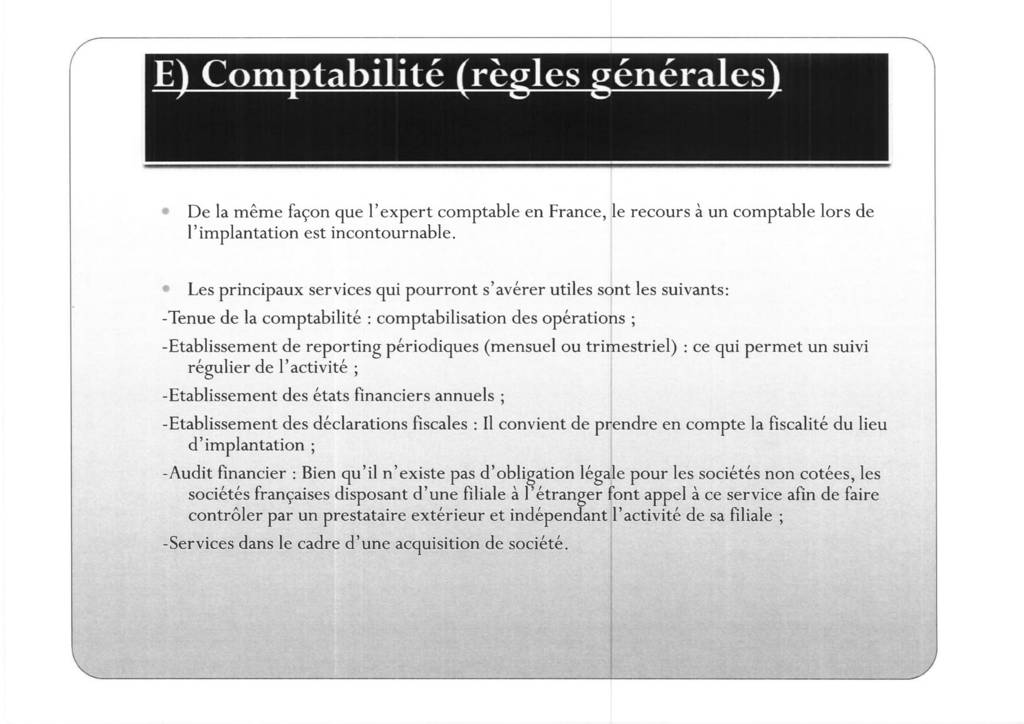
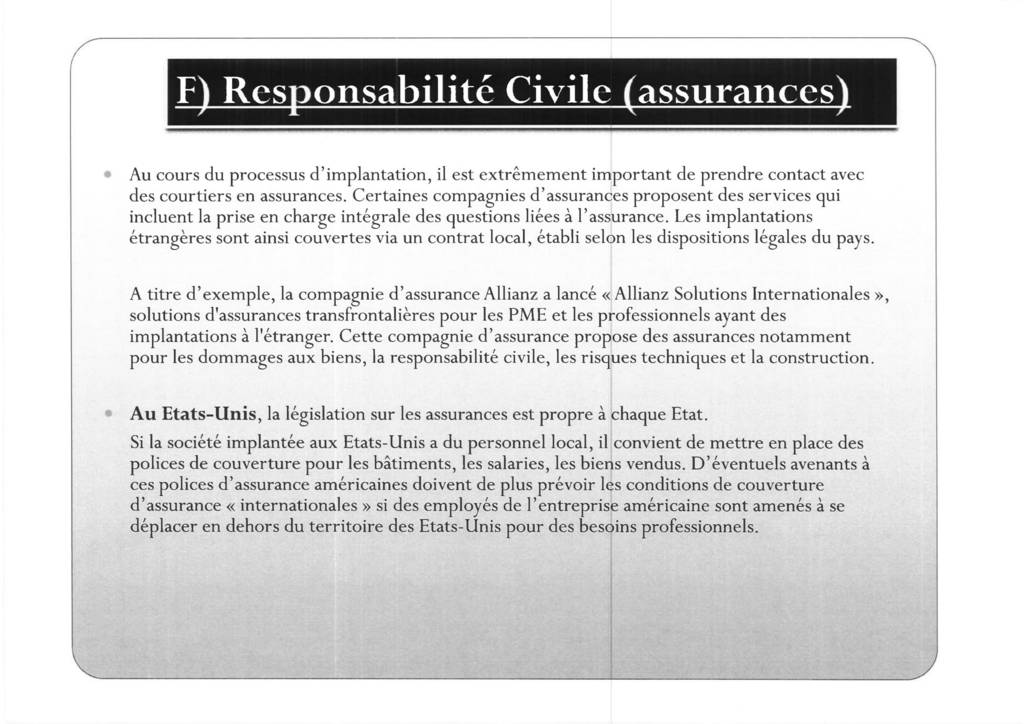
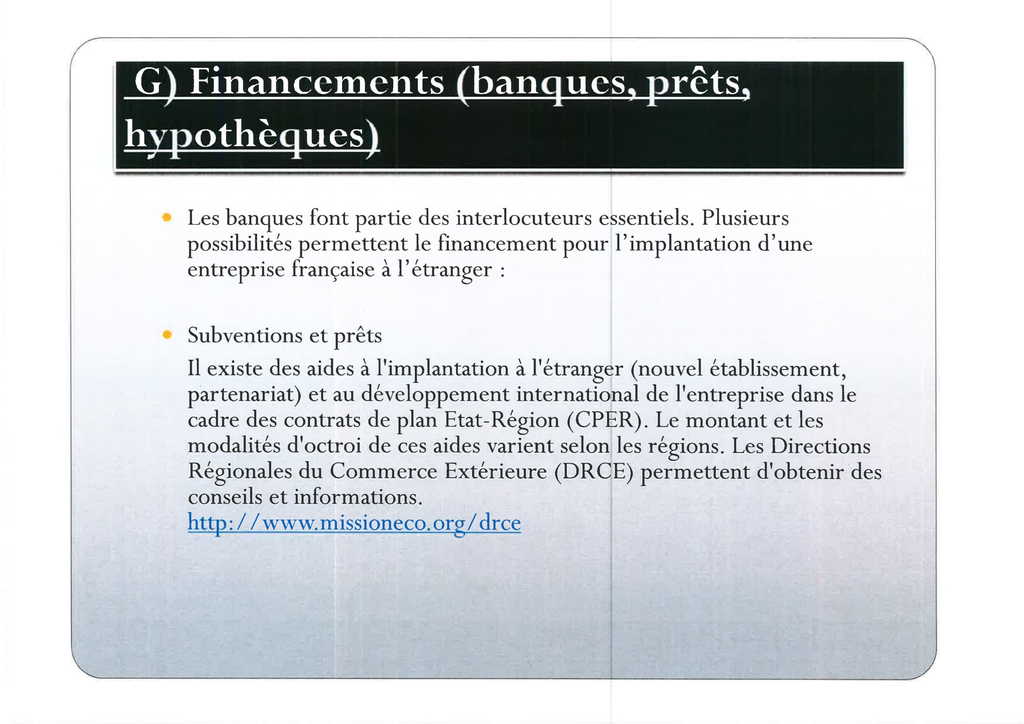
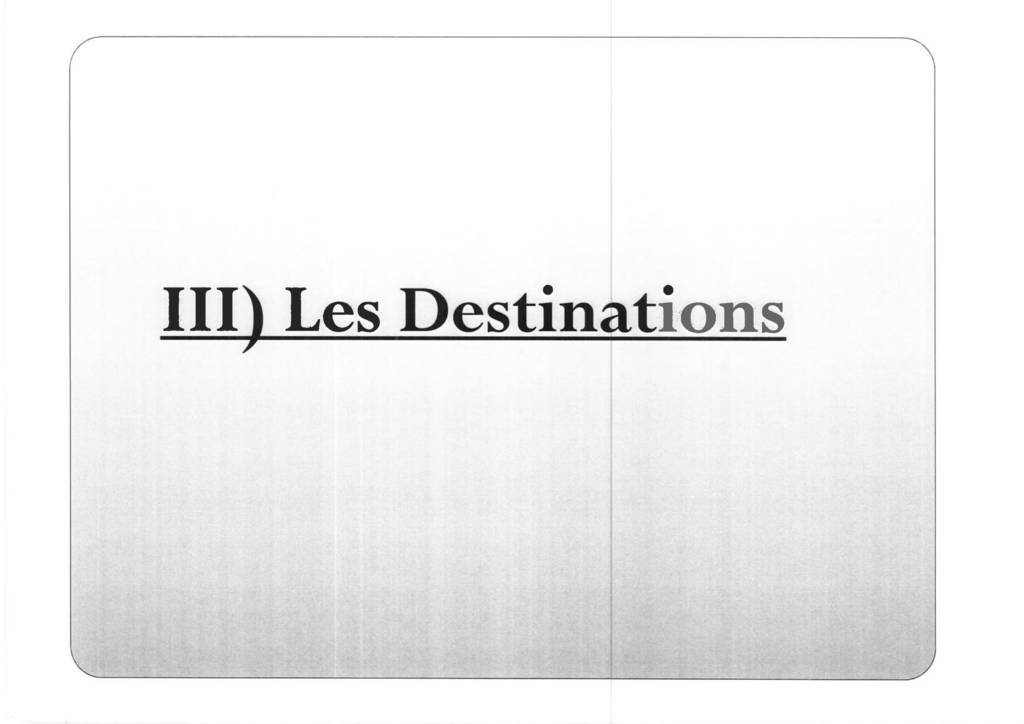
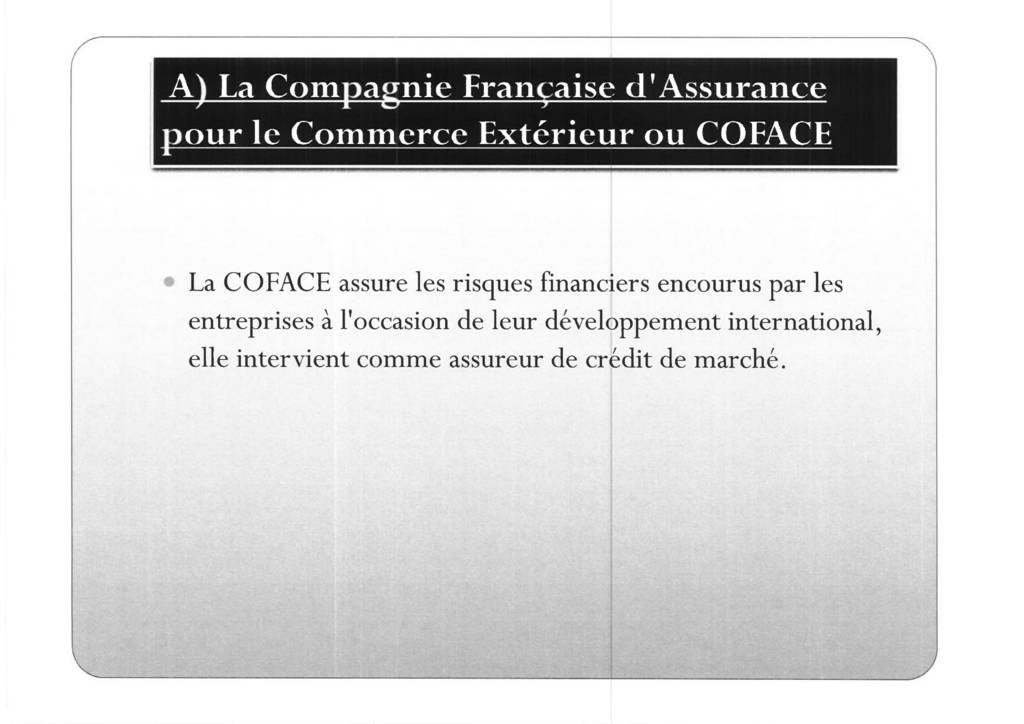
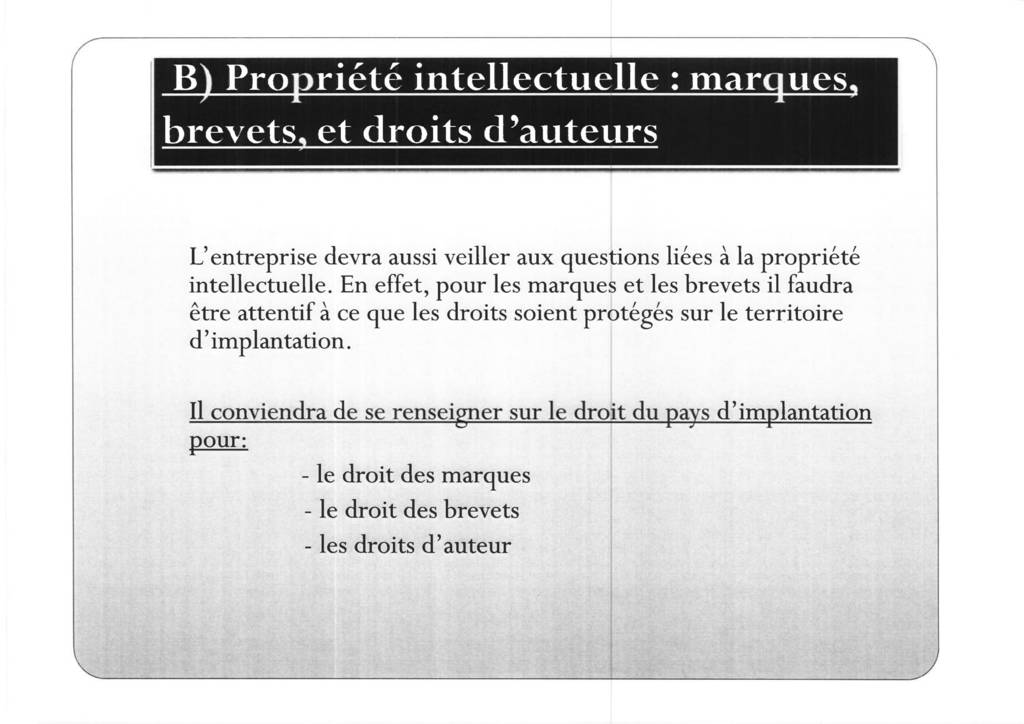
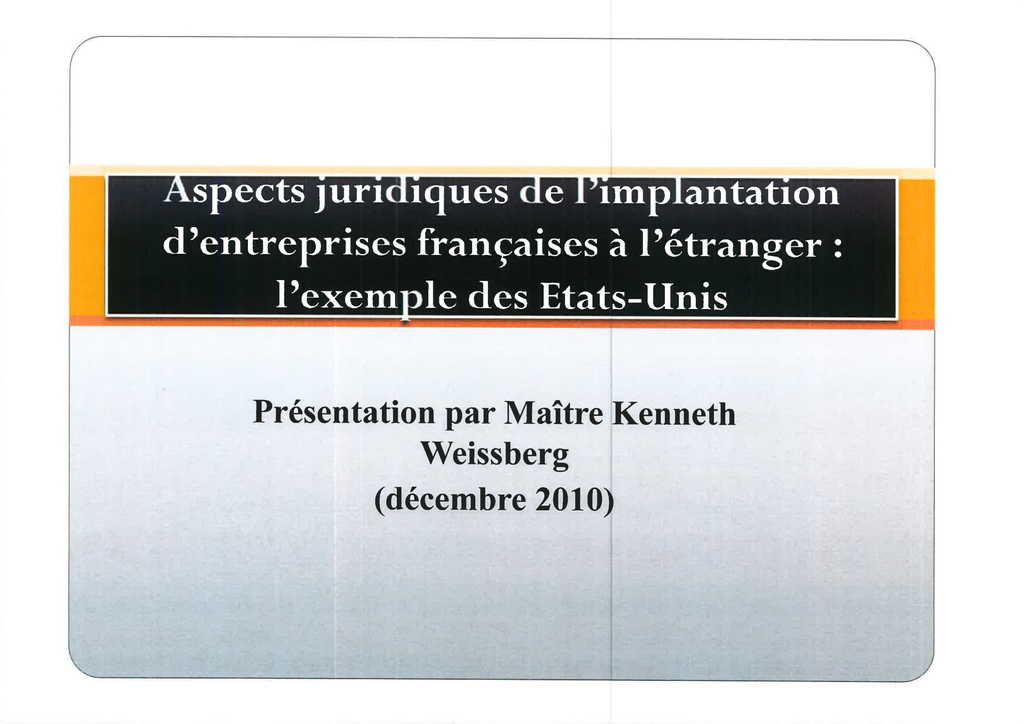
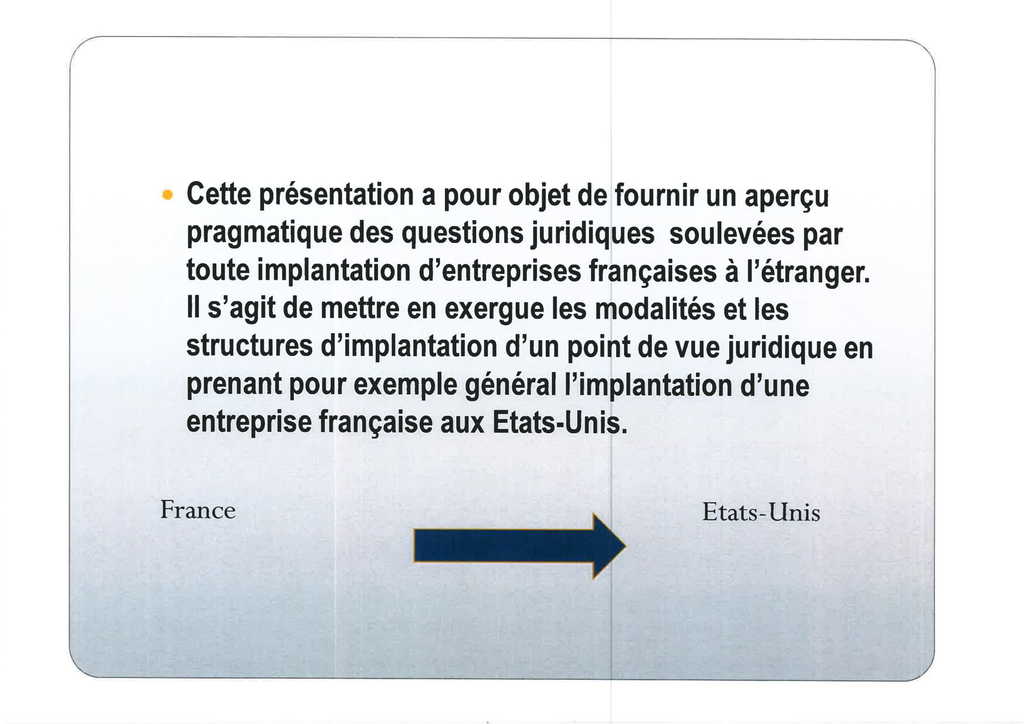
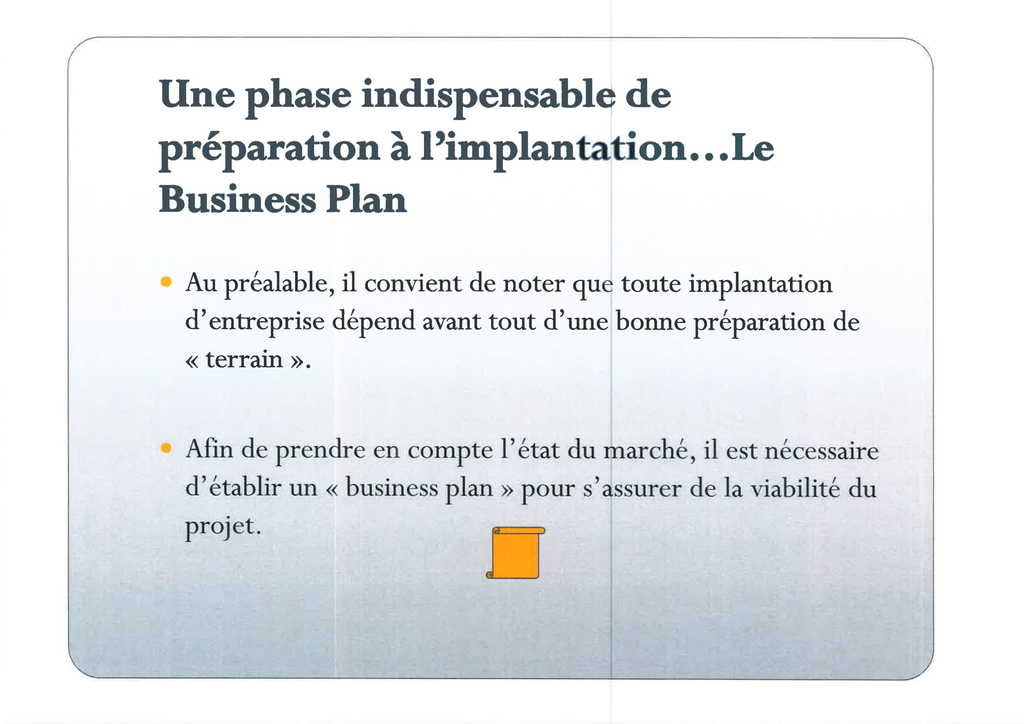
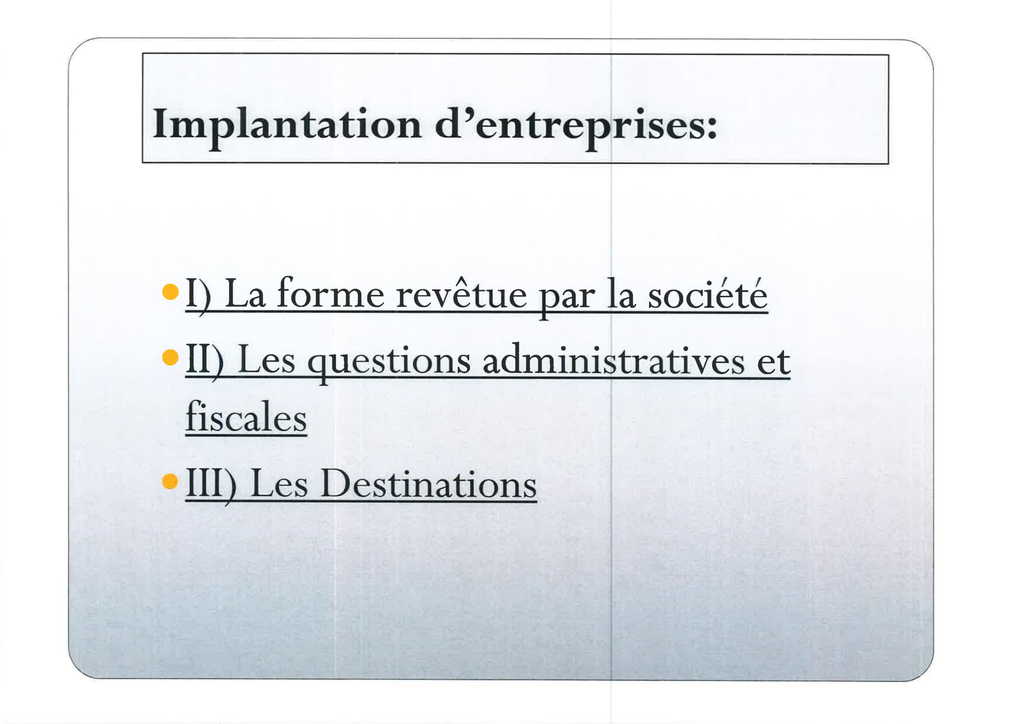
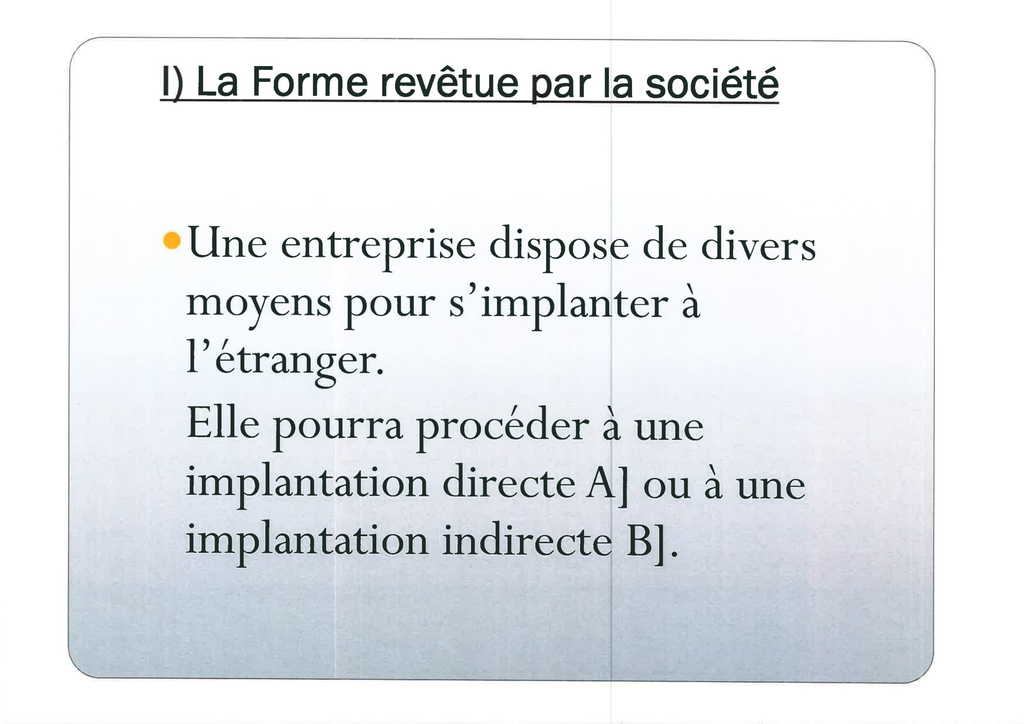
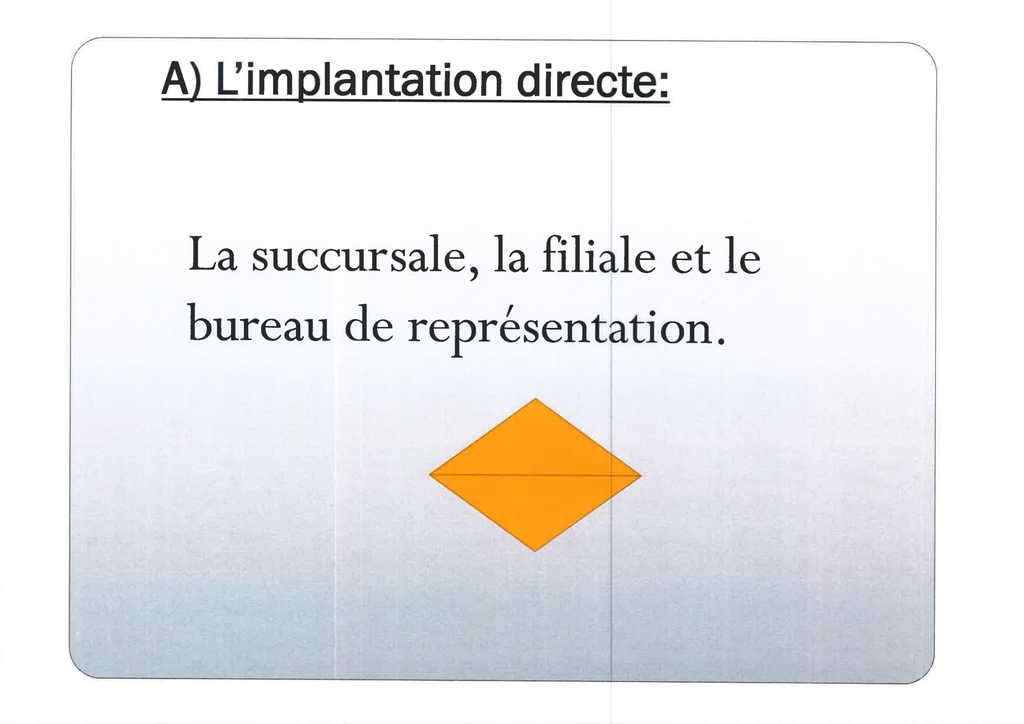
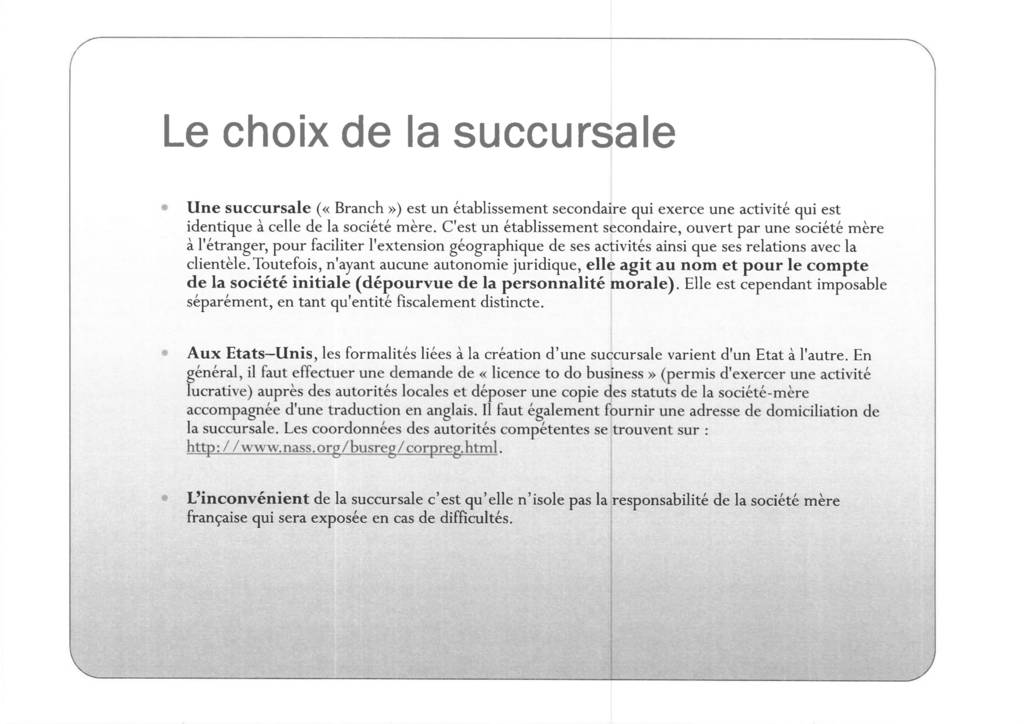
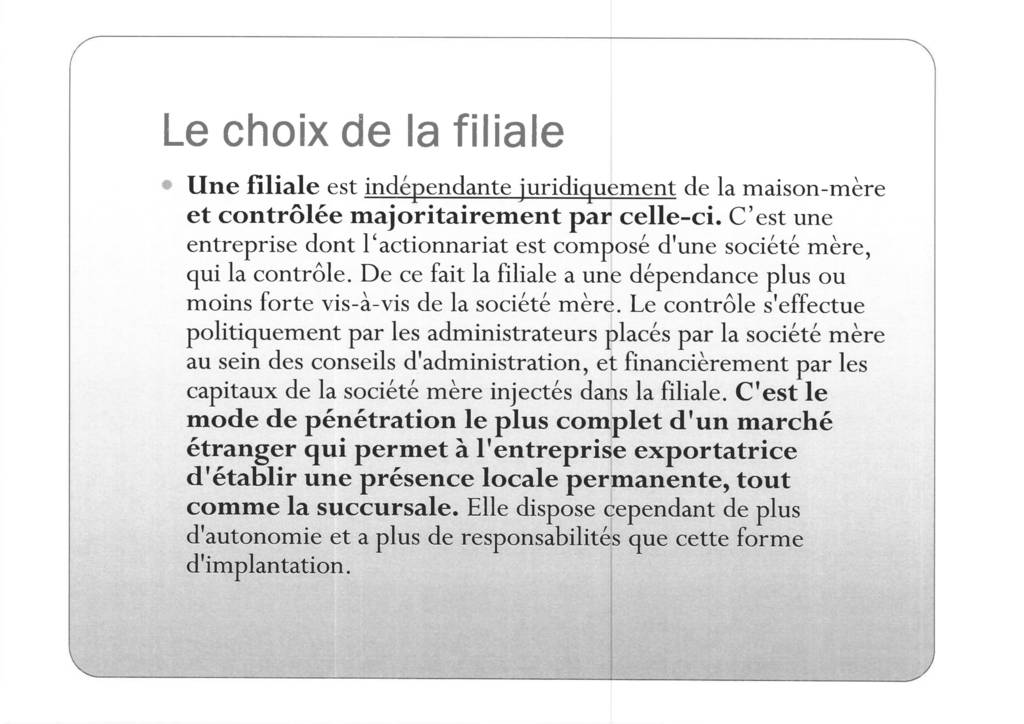
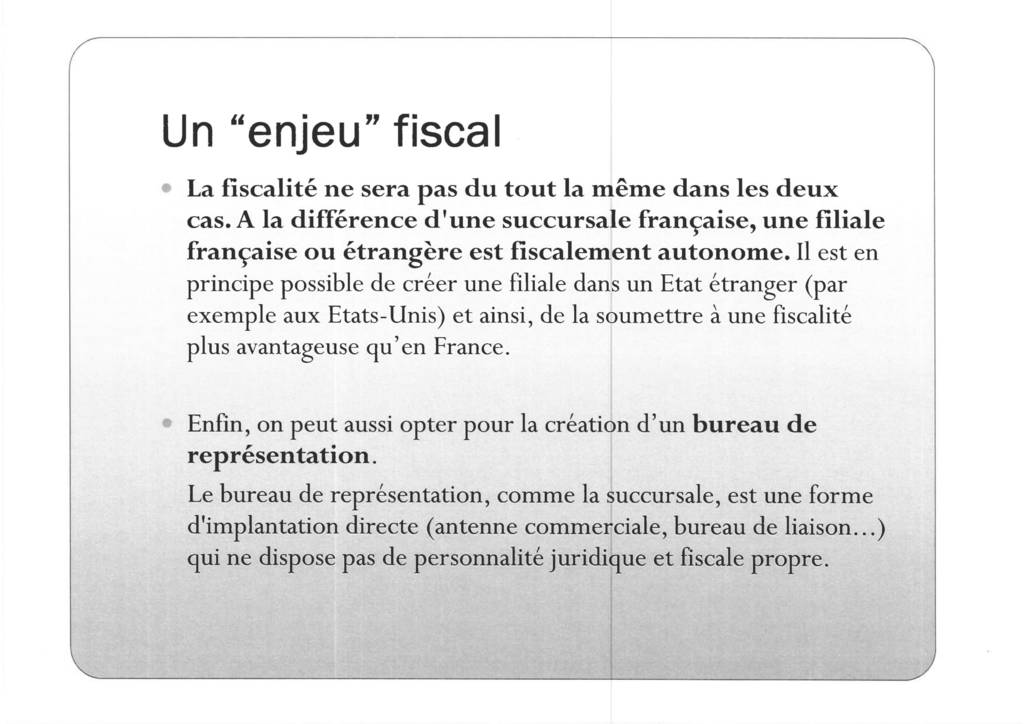
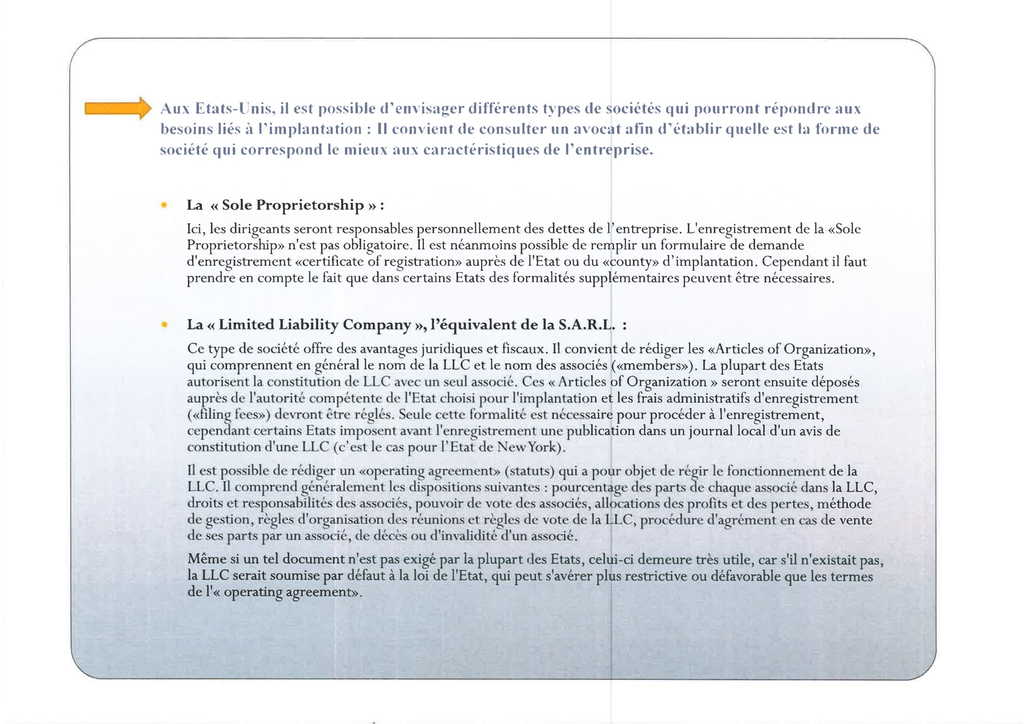
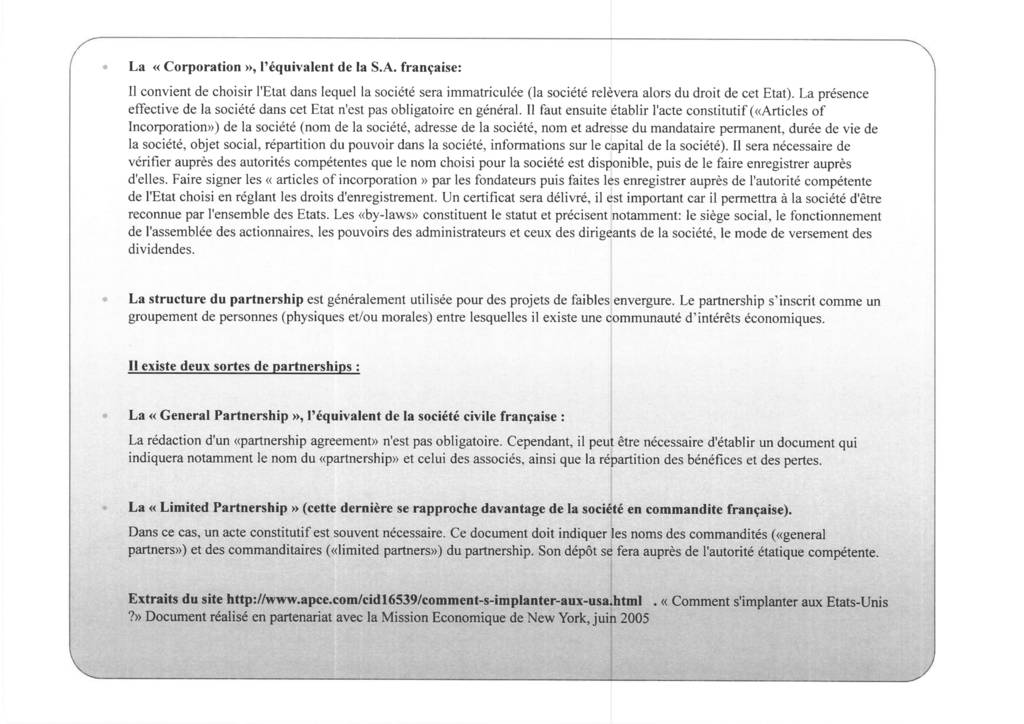
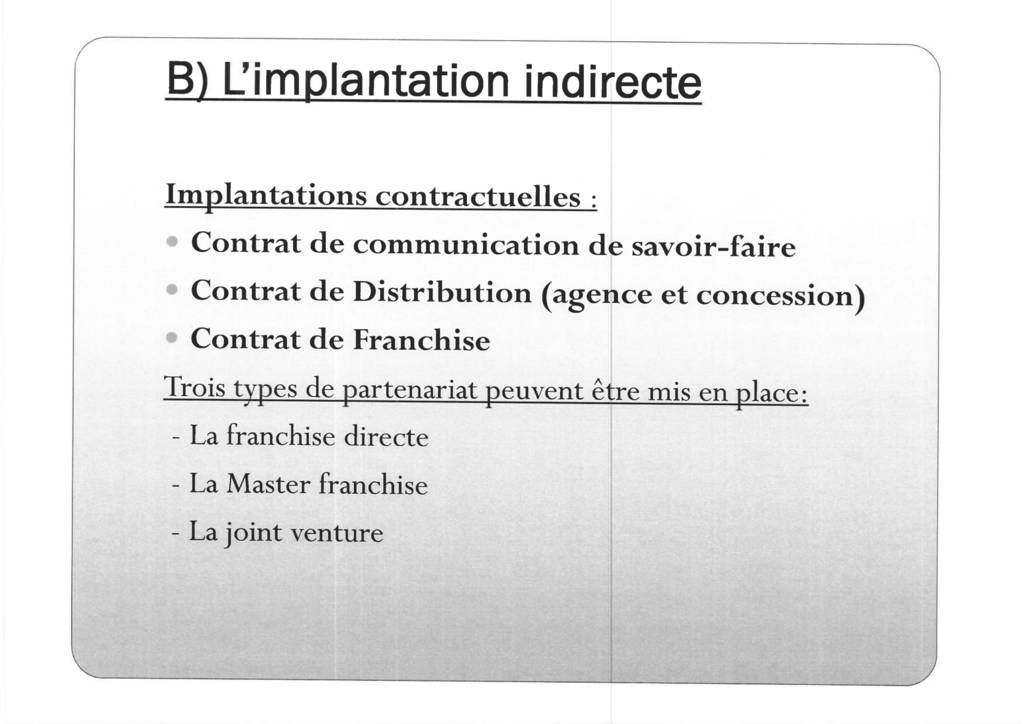
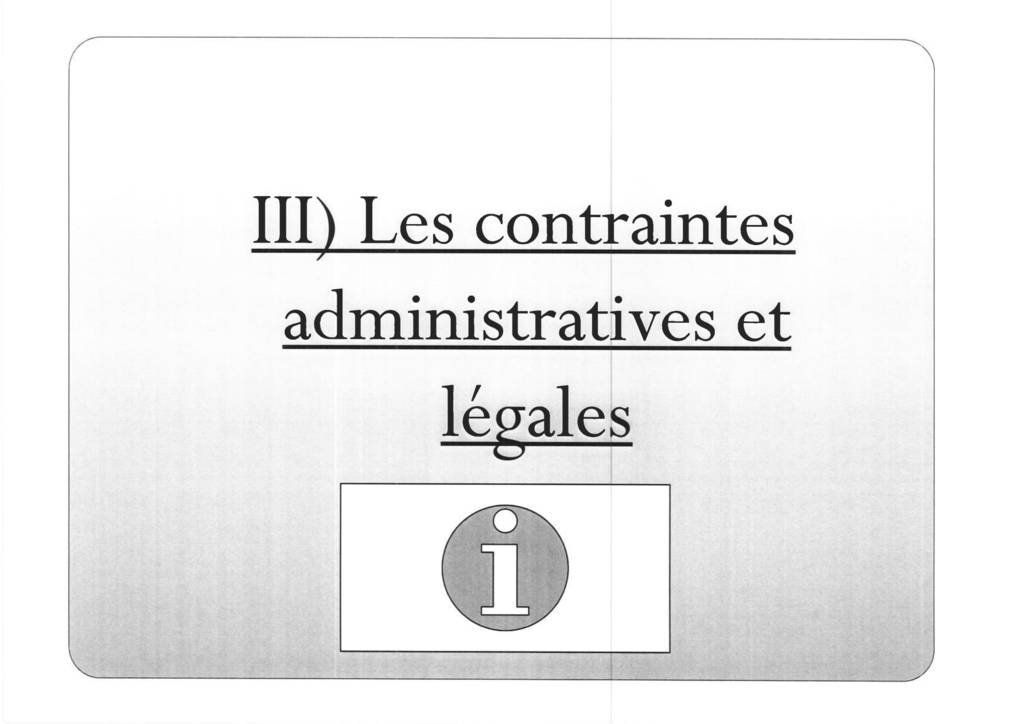
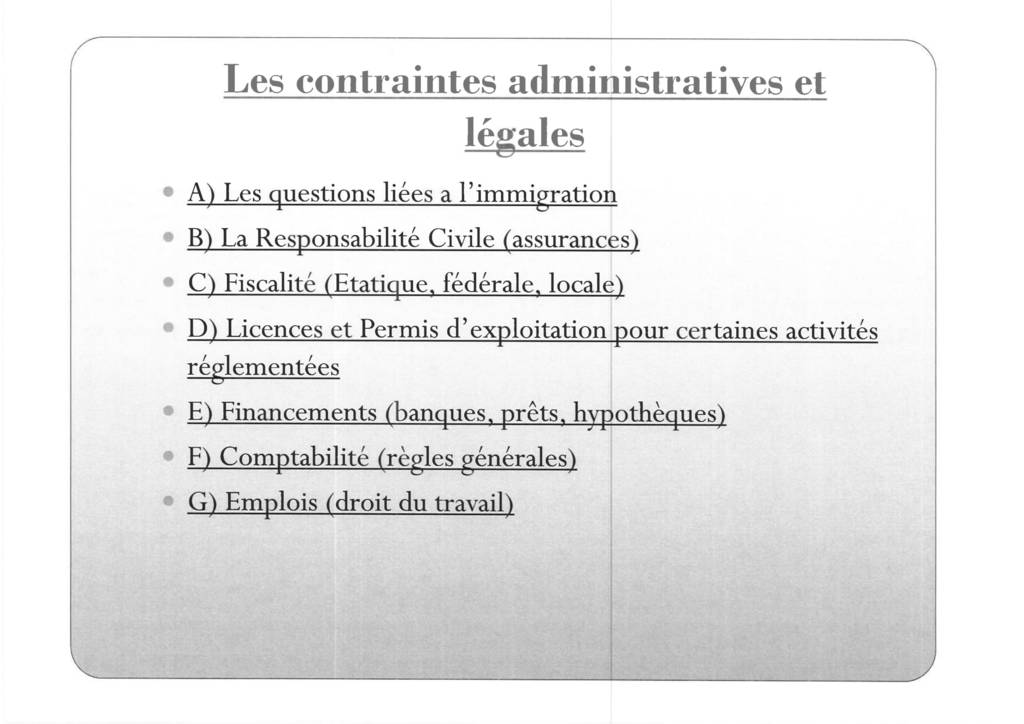
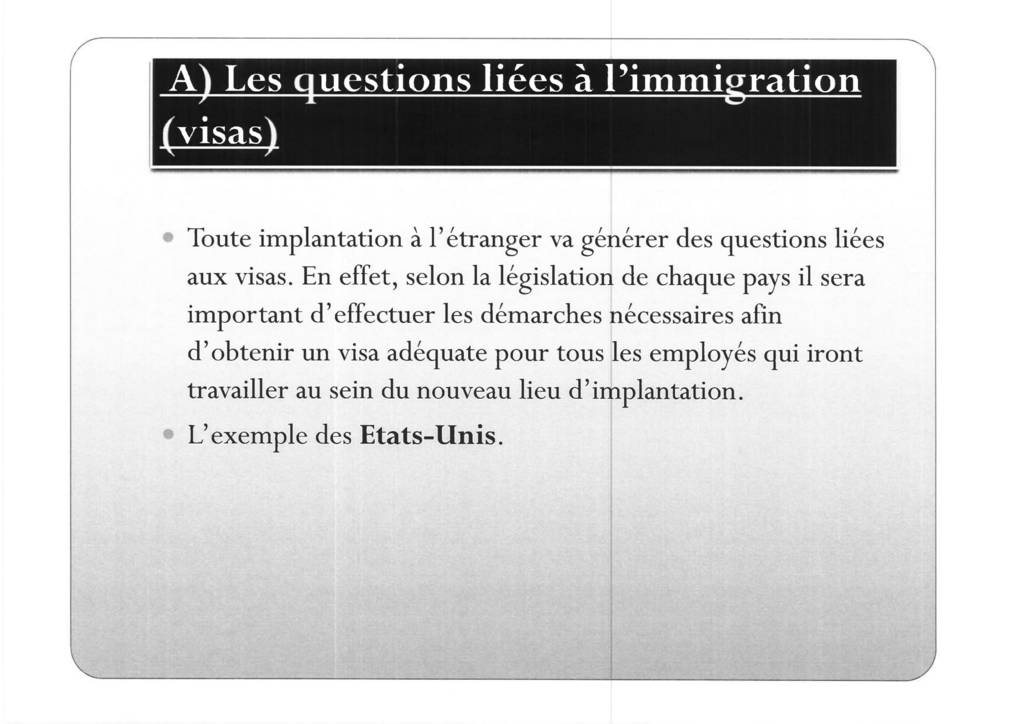
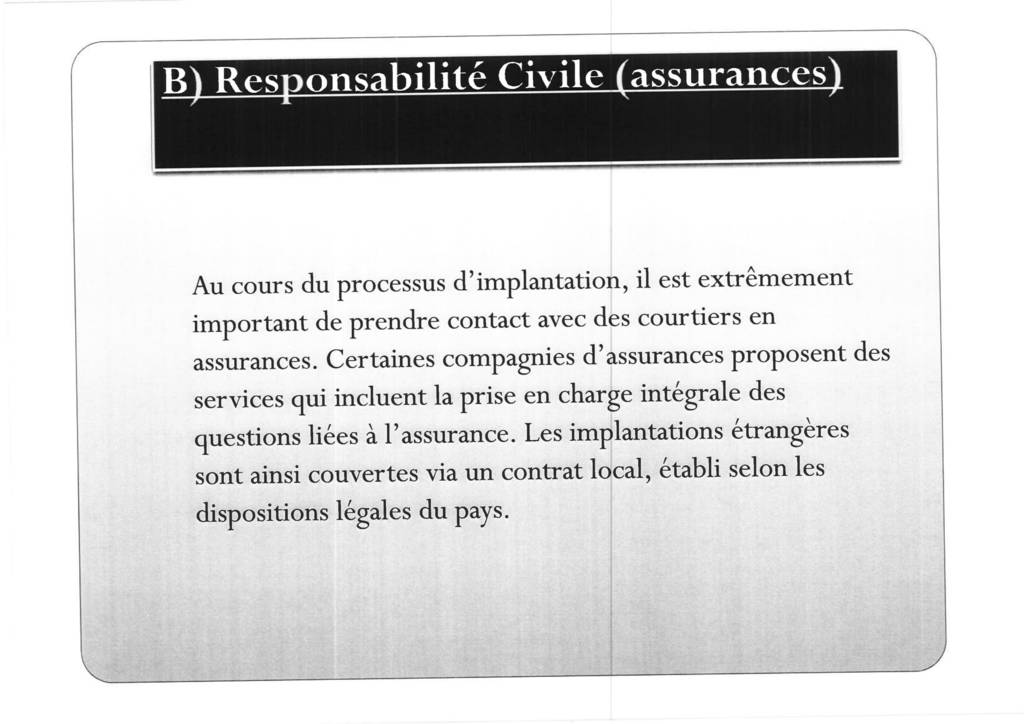
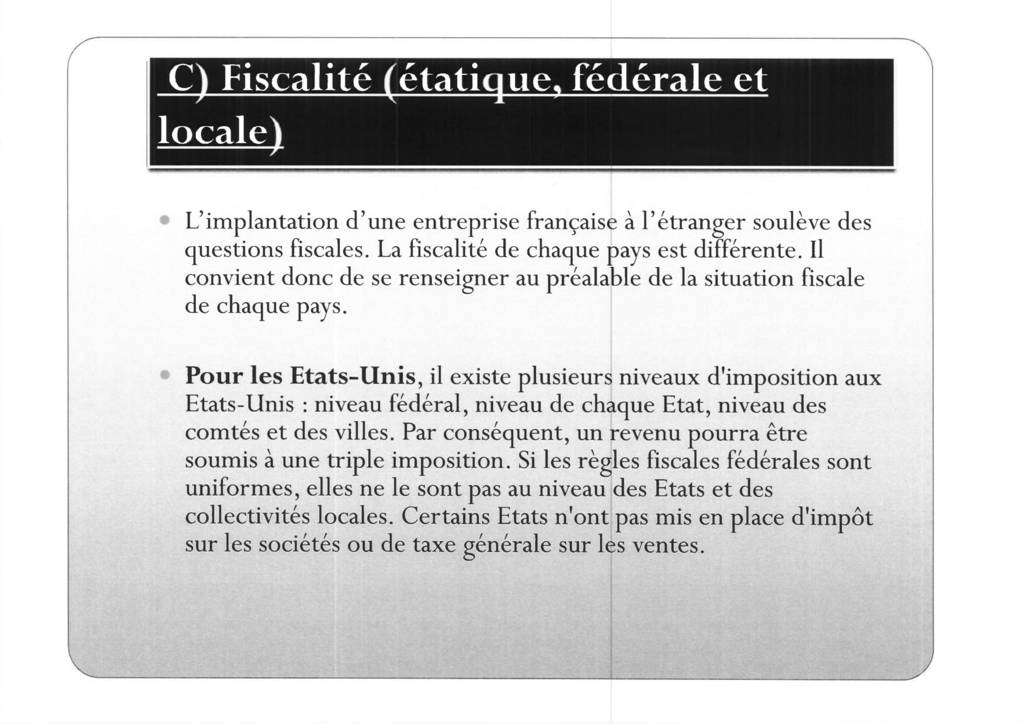
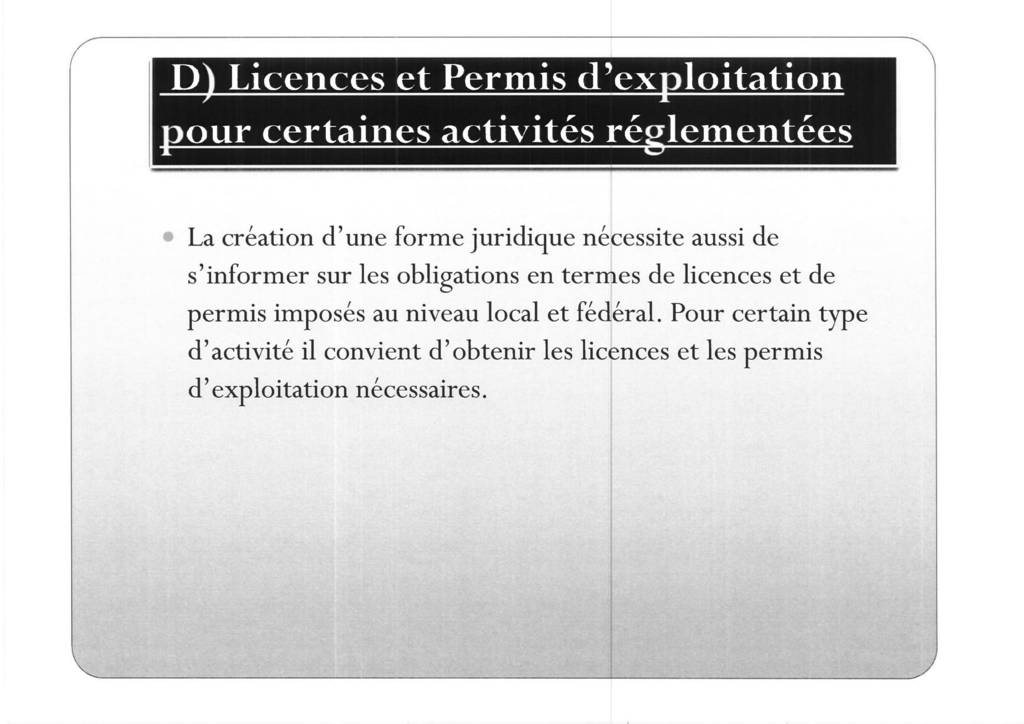
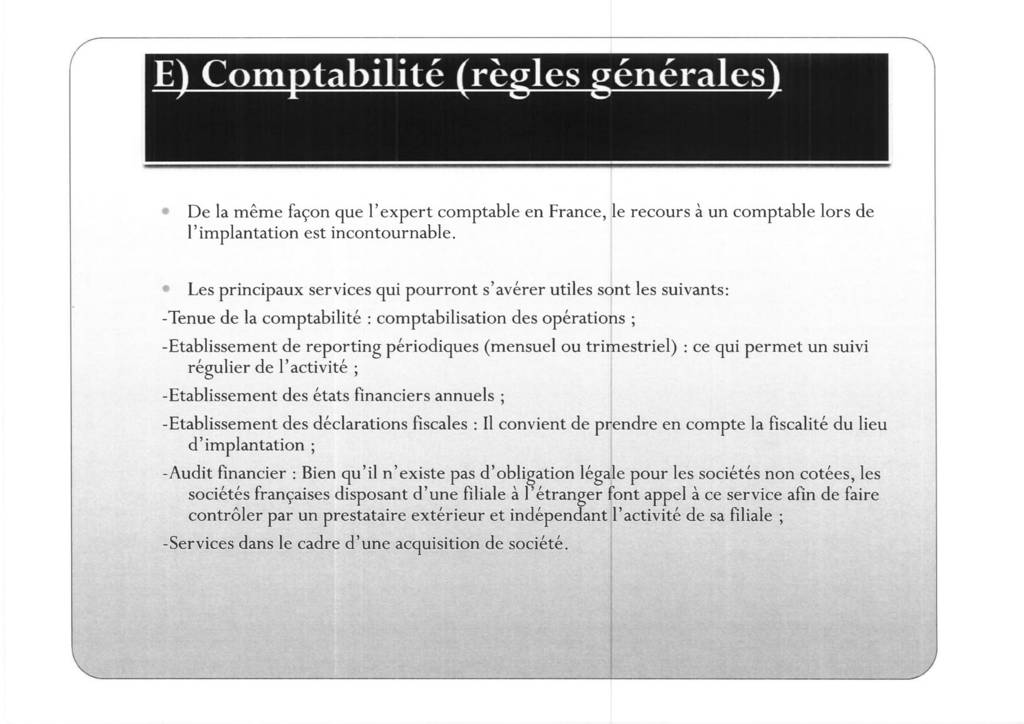
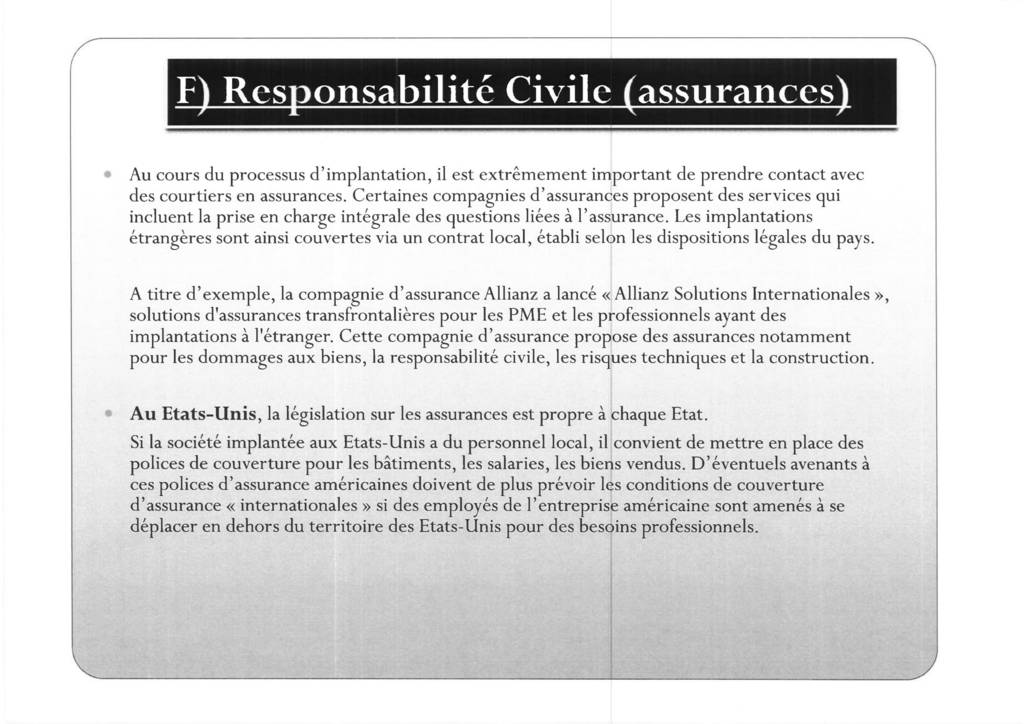
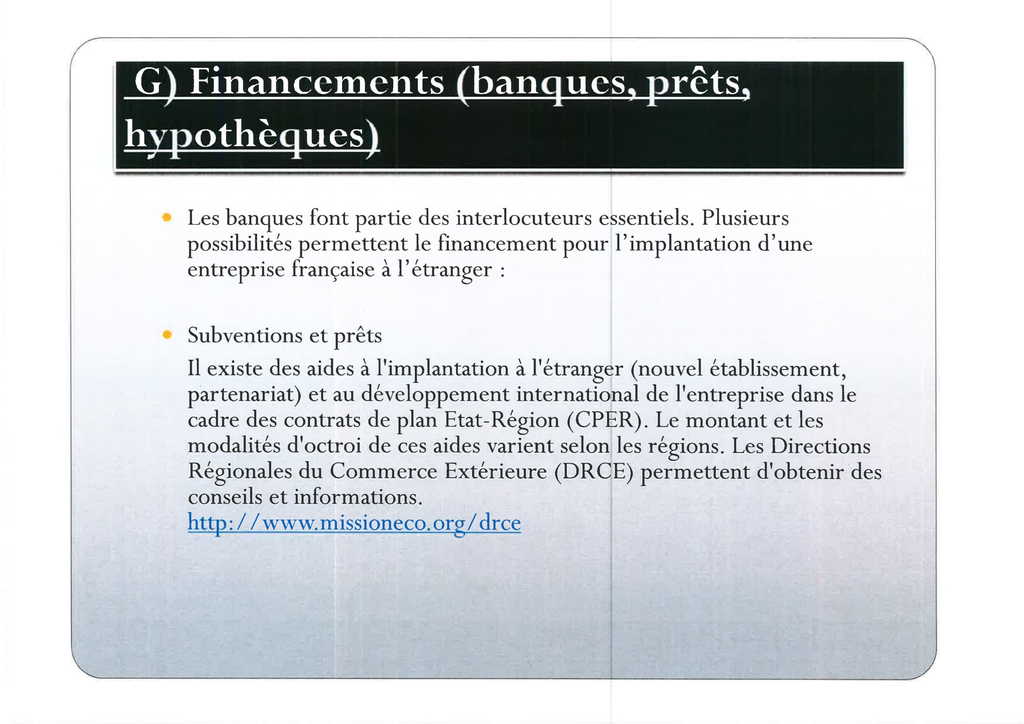
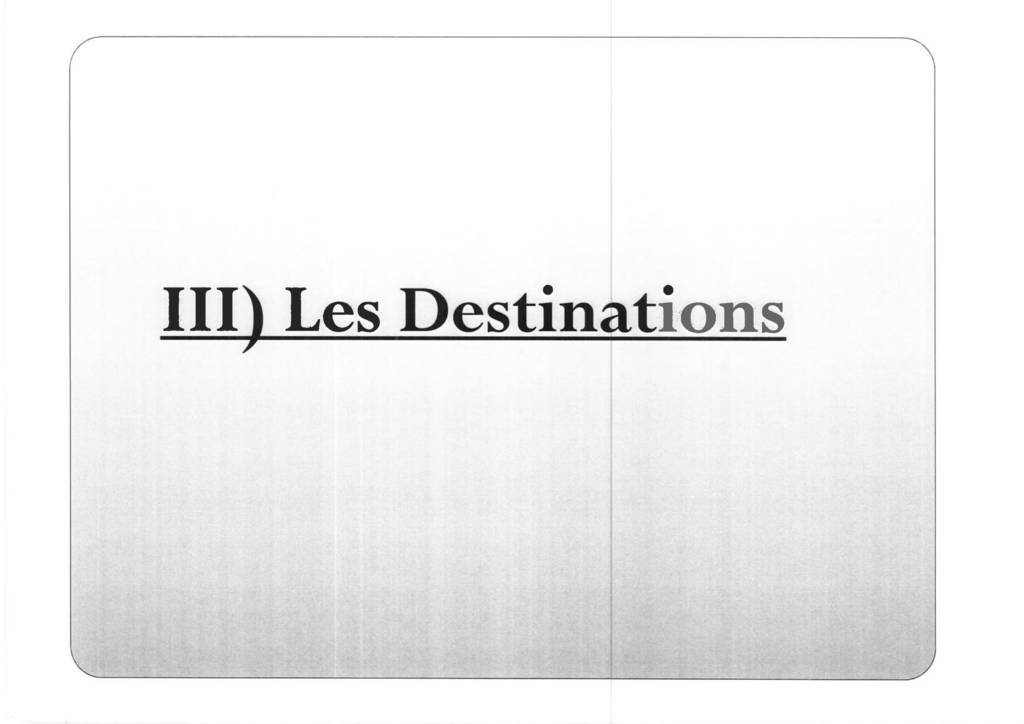
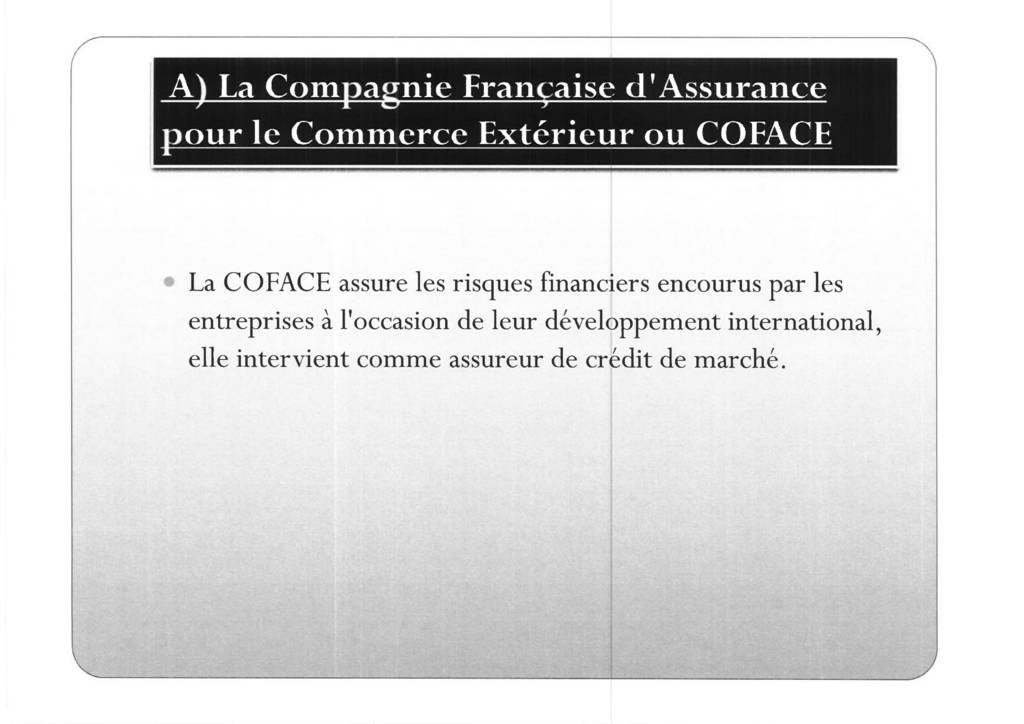
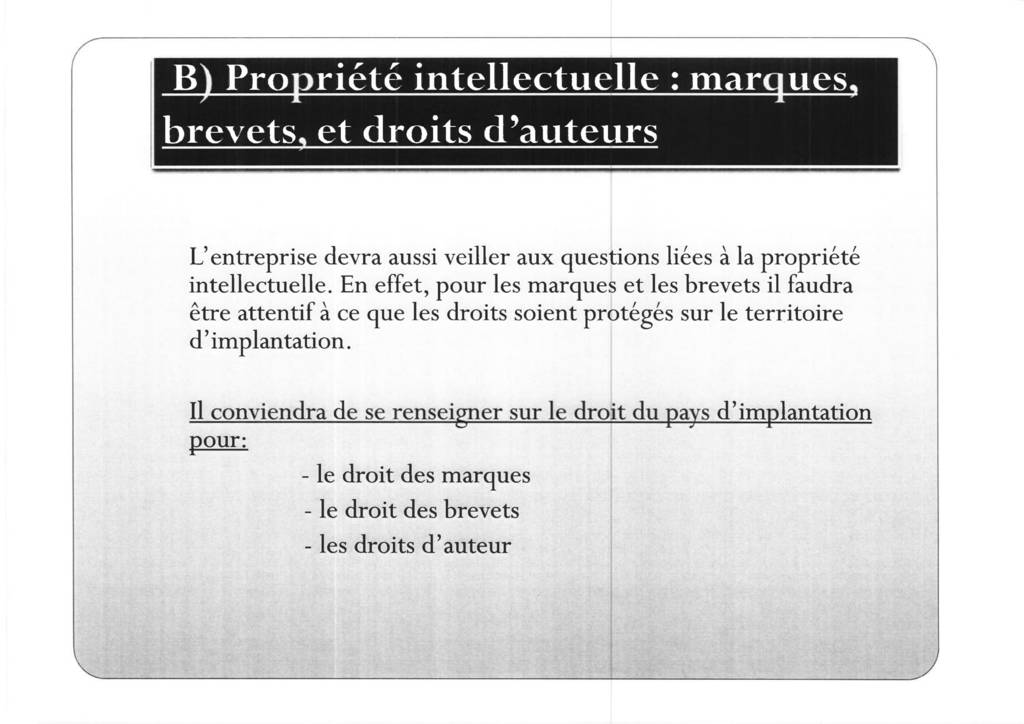
“The life and blood of international commerce ” (1) tel est le terme employé par les tribunaux anglais pour caractériser le crédit documentaire.
Le crédit documentaire peut être défini comme « l’opération par laquelle un banquier, intervenant sur l’ordre d’un acheteur pour le règlement financier d’une opération commerciale, le plus souvent internationale, promet de payer le vendeur contre remise de documents » (2).
Selon le doyen Jean Stoufflet la technique du crédit documentaire est « la plus belle réussite du commerce international en matière de mécanisme bancaire » (3).
D’autres auteurs l’ont qualifié de « véritable chef-d’oeuvre de technique bancaire » (4).
En effet, dans les affaires internationales, du fait de l’éloignement géographique des cocontractants qui souvent, ne se connaissent pas et il leur est difficile de se faire confiance à la première opération.
L’exportateur hésite à entreprendre la fabrication ou la livraison d’un produit s’il n’est pas sûr de se faire payer. De son coté, l’importateur hésite à verser des fonds à l’exportateur avant d’être sûr que l’expédition a bien été effectuée dans les délais prescrits.
Le crédit documentaire, en faisant intervenir les intermédiaires indépendants et solvables que sont les banques, constitue donc un moyen de paiement qui a l’avantage de concilier les intérêts divergents de l’acheteur et du vendeur.
Le vendeur est assuré de recevoir contre remise de certains documents, le prix qui lui est dû en raison de la livraison de la marchandise dans les délais convenus.
L’acheteur, quant à lui, ne devra payer la marchandise commandée que si elle lui a effectivement été expédiée.
À ce titre, on peut estimer que le crédit documentaire est un instrument de la confiance qui s’appuie sur le système bancaire international.
Ainsi la myriade de transactions commerciales, l’évolution des échanges internationaux font de crédit documentaire l’un des instruments les plus importants du commerce international.
Par conséquent, le développement monumental du commerce international en Chine s’accompagne nécessairement l’essor du crédit documentaire, on peut même dire qu’en Chine l’utilisation du crédit documentaire est une opération incontournable pour la réalisation des transactions commerciales avec des partenaires étrangers.
Dans le milieu des affaires internationales, le crédit documentaire a fait l’objet d’une
réglementation émanant de la Chambre de commerce internationale (CCI), organisation
privée internationale qui a élaboré des règles uniformes applicables par les commerçants
relevant de systèmes économiques et juridiques très différents. L’effectivité de ces règles a été
démontrée par la pratique et sanctionnée par la jurisprudence. Ces « Règles et Usances
uniformes relatives aux Crédits documentaires » (RUU) ont été publiées pour la première fois
en 19335. Révisées régulièrement pour suivre et accompagner les évolutions de la pratique,
leur dernière version les « RUU 600 » remplaçant la précédente version les RUU 500 datant
de 1993 est entrée en vigueur le 1er juillet 2007. Les RUU en tant que lex mercatoria reçoit
par conséquent sa pleine application en Chine du fait qu’on reconnaît le droit des parties de
choisir la règle de droit applicable dans les transactions internationales impliquant l’utilisation
du crédit documentaire.
En revanche, au niveau national, il n’existait il y a 4 ans en Chine, comme dans beaucoup
d’autres pays, dont la France, aucune disposition légale ou réglementaire régissant le crédit
documentaire. Le droit étatique chinois qui a vocation à s’appliquer pour compléter les
lacunes éventuelles des RUU est constitué par les dispositions contenues dans la Loi sur les
Principes Généraux du Droit Civil, la Loi sur les Contrats, la Loi des sûretés et la Loi de la
Procédure Civile. Cependant, du fait que ces dispositions sont généralement très floues et sont
donc susceptibles d’interprétation du juge, et que la jurisprudence n’est pas une véritable
source de droit en Chine, depuis 1995, les litiges concernant les crédits documentaires ont été
abondamment portés devant la cour populaire de la Chine.
Jusqu’en 2004, la Cour Suprême de la Chine s’est prononcé sur plus de cent affaires, sans
compter des centaines de questions relatives aux crédits documentaires posées à la Cour
Suprême par les cours inférieures. Ainsi, China Banking Regulatory Commission, les banques
commerciales ont eux aussi posé des questions sur l’exécution des jugements du tribunal
concernant les crédits documentaires, étant donné que les explications juridiques ou les
règlements émanant de la Cour Suprême constituent l’une des sources de droit les plus
importantes dans le système juridique chinois.
Eut égard à ces diverses questions soulevées dans la pratique, particulièrement s’agissant de la loi applicable au crédit documentaire, du critère de la vérification des documents, de la fraude etc., la Cour Suprême de la Chine, après avoir fait une étude globale et des discussions avec les juristes, les praticiens, les banques et les experts de la CCI en Chine, en s’inspirant des RUU500, a adopté le 24 octobre 2005 le Règlement de la Cour Suprême sur quelques questions concernant les litiges portant sur le crédit documentaire, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2006. Bien que les dispositions générales prévoyant dans les lois précitées soient toujours applicables, le Règlement fournit aux juges et ainsi aux praticiens plus d’exactitude et de précision en cas de divergence d’interprétation et complète également des lacunes sous les RUU. Néanmoins ce Règlement n’est pas dépourvu de défauts, surtout depuis l’entrée en vigueur des RUU 600.
Concernant le champ d’application du Règlement de la Cour Suprême sur quelques questions
concernant les litiges portant sur le crédit documentaire, son premier article prévoit que le
Règlement s’applique aux litiges portant sur l’émission, la notification, la modification, la
révocation, la négociation et la levée du crédit documentaire. Ici, le mot « révocation »
s’entend de l’application de Règlement aux crédits documentaires révocables. L’expression
crédit révocable désigne le crédit documentaire qui peut être amendé ou annulé par la banque
émettrice à tout moment et sans accord ni information du bénéficiaire6.
Cependant dans la pratique, les crédits révocables ont disparu depuis plusieurs années. Tirant
les enseignements de cette évolution, les RUU 600 ne font plus référence à la notion de crédit
révocable. Elaboré sous l’emprise des RUU 500, le Règlement n’a pas pris en compte de cette
évolution, ce qui donne en revanche à la banque émettrice ou confirmante la possibilité
d’assortir l’irrévocabilité de leur engagement de paiement des conditions remettant en cause
le principe même de cet engagement. Ces conditions dites des « soft clauses » auraient pour
conséquence de faire des crédits documentaires révocables et donc nuisent considérablement à
l’intérêt du bénéficiaire. En effet, seul le crédit irrévocable est une véritable garantie pour le
bénéficiaire dans la mesure où ce type de crédit constitue un engagement ferme du banquier
émetteur. La révocabilité du crédit documentaire est contraire au principe même de cette
garantie, en conséquence il serait préférable pour le Règlement de supprimer dans son champ
d’application la révocation du crédit documentaire pour être compatible avec les RUU 600 et
refléter réellement la pratique commerciale.
Le présent article se limite à présenter deux points essentiels du crédit documentaire prévues
par le Règlement qui suscitent dans la pratique plus de problèmes, à savoir la vérification des
documents (I), et la fraude du crédit documentaire (II), ainsi que quelques réflexions sur ces
points au regard des règles des RUU600.
La vérification des documents est une mission essentielle du banquier dans le cadre d’un crédit documentaire. Ainsi que le relève M. Affaki, « dans une opération qui est marquée par la séparation entre le contrat commercial sous-jacent et l’intervention bancaire, le dénouement de cette intervention est fonction exclusivement de documents et non de la réalisation de faits qui peuvent y être reflétés» (7). C’est une source importante et croissante de contentieux dans la pratique du crédit documentaire. Cette situation nuisait évidemment à la sécurité de la technique. Il est apparu que plus de 70 % des premières présentations étaient irrégulières. La plupart des difficultés porte sur des questions de conformité des documents. C’est donc l’un des objets du Règlement que de réduire le plus possible les risques de rejet pour irrégularité des documents.
L’article 5 du Règlement prévoit que la banque émettrice est tenue d’honorer son engagement pris dans le crédit documentaire lorsque les documents présentés sont conformes en apparence aux termes du crédit, et tous les documents sont apparemment compatibles entre eux. Il en ressort que le critère de la vérification des documents en Chine est le critère de la stricte conformité des documents avec les stipulations du crédit documentaire. Il est évident que le banquier ne peut pas connaître tous les usages commerciaux et en conséquence le bénéficiaire ne pourra pas lui demander de considérer comme conformes des documents qui ne sont pas strictement identiques aux stipulations du crédit.
Ainsi une banque n’a pas à interpréter la désignation d’une marchandise, même lorsque les
termes utilisés dans les documents distincts de ceux du crédit, pour des professionnels du
commerce strictement équivalents. Dans un arrêt de Cour d’appel de Guansu le 25 juin 2007,
la Cour a soutenu le refus du paiement par la banque confirmante en considérant que le nom
de la marchandise « raisins » stipulant sur la facture n’est pas conforme au nom « dried
currents » figurant dans le crédit documentaire, bien que dans le commerce international ce
soit quasiment les mêmes marchandises. Il est donc à noter que le critère de la conformité
substantielle n’a pas été retenu par la Cour populaire chinoise, ce qui est contraire à la
jurisprudence de certains pays et notamment des Etats-Unis. En conséquence l’article 5 du
Règlement limite l’obligation du banquier à un contrôle d’apparence de présentation
conforme. Il s’agit là d’une règle protectrice du banquier chargé de la vérification qui ne
profite pas au bénéficiaire.
Néanmoins, le principe de stricte conformité a été fortement atténué par le Règlement, ce qui
est également la tendance jurisprudentielle, puisque l’article 6 alinéa 2 précise que dans le cas
où l’apparente conformité des documents par rapport aux stipulations du crédit et la
compatibilité inter documentaire ne sont pas strictement satisfaites, dès lors qu’il n’y a pas
d’ambiguïté ni de contradiction entre eux, la Cour populaire peut considérer que les
documents sont conformes. Ainsi la Cour d’appel de Shanghai a cassé une décision ayant
écarté la responsabilité d’une banque émettrice vis-à-vis du bénéficiaire en qualifiant de
divergence « purement formelle » qui n’engendrait pas d’ambiguïté le fait que sur un
document de transport, les noms du destinataire de la marchandise et celui devant recevoir
notification de l’arrivée de cette marchandise, figuraient dans des cases inappropriées et ne
correspondant pas à la stipulation du crédit documentaire.
De ce point de vue, le Règlement essaie de maintenir l’équilibre entre les intérêts du banquier
et le bénéficiaire tout en préservant le principe de la stricte conformité des documents par
rapport aux stipulations du crédit. Néanmoins, des dispositions du Règlement rédigées de
façon très générale sont susceptibles d’interprétations différentes, surtout par rapport aux
RUU600 qui prévoit des dispositions détaillées par différents types de documents. En
conséquence, ces dispositions ne donnent pas de réponses claires aidant les tribunaux à
statuer.
La régularisation de documents rejetés est toujours possible dès lors que le crédit n’est pas
expiré et que les irrégularités sont susceptibles de corrections. En revanche, lorsque la
régularisation des documents n’est pas possible, l’article 7 du Règlement autorise la banque
émettrice, à sa seule discrétion, de requérir l’accord du donneur d’ordre pour accepter des
documents irréguliers.
Cependant, l’autorisation de lever les documents irréguliers donnée par donneur d’ordre
n’oblige pas le banquier émetteur au paiement du crédit au bénéficiaire. Lorsque l’émetteur a
refusé la levée des documents irréguliers, la demande de paiement du bénéficiaire qui se
prévaut de l’acceptation des irrégularités par le donneur d’ordre, doit être rejetée par la cour.
Ceci est contraire à la jurisprudence française, puisque dans un arrêt de 11 mars 2003, la Cour d’appel de Paris a décidé que la banque était obligée au paiement dans des circonstances où le donneur d’ordre, déclaré entre-temps en redressement judicaire, avait donné son accord pour le paiement de documents irréguliers. Néanmoins, rappelons que la banque n’a aucune obligation de solliciter du donneur d’ordre une éventuelle levée des documents irréguliers même si celui-ci, sans être interrogé par la banque, entend accepter les documents. Le formalisme du crédit documentaire autorise le banquier, quelle que soit la position du donneur d’ordre sur l’exécution du contrat de base, à refuser d’honorer son engagement dès lors que les documents présentés au soutien de la demande ne sont pas strictement conformes aux spécifications de la lettre de crédit8.
Certains juristes chinois considèrent cependant que cet article, autorisant le banquier à refuser
les documents irréguliers même avec l’accord du donneur d’ordre, pour conséquence de nuire
aux intérêts du donneur d’ordre et du bénéficiaire, et d’alourdir considérablement le coût des
transactions internationales en mettant tout accent sur le principe de l’autonomie du crédit
documentaire. Cet article ne tient pas compte du but du crédit document, qui est d’assurer le
paiement de la transaction commerciale dont le bon déroulement et le bon résultat, but
poursuivi par les parties, à savoir le donneur d’ordre et le bénéficiaire du crédit documentaire.
La fraude est la seule exception qui puisse faire obstacle au libre jeu des mécanismes du crédit documentaire. Elle fait notamment obstacle au paiement de documents qui ont l’apparence de régularité (9). Bien que la maxime fraus omnia corrumpit soit généralement admise par tous les systèmes juridiques, en matière de crédit documentaire, la qualification de fraude et sa prise en compte sont bien fluctuantes (10) . Compte tenu des divergences relatives à la fraude entre les différents systèmes juridiques, les RUU600 laisse délibérément le problème aux droits nationaux.
Sur cette problématique qui engendre autant de difficulté que la vérification des documents
dans la pratique tant pour le banquier que pour la Cour, le Règlement éclairci donc la
qualification de la fraude du crédit documentaire et son effet vis-à-vis des banquiers, le
donneur d’ordre et le bénéficiaire. Cependant, cette qualification est discutable, selon bien des
juristes et praticiens, car sa portée considérée trop large.
L’article 8 prévoit que la fraude est établie lorsque le bénéficiaire :
Aux termes de cet article, il est intéressant de constater qu’en énumérant des cas de figure de la fraude, il n’en donne pas la définition ni les caractéristiques, ce qui laisse entendre que l’article s’applique à toutes les fraudes prévues dans ces quatre cas de figure, contrairement à la jurisprudence américaine ou française qui exige que la fraude soit substantielle ou manifeste.
Cela aurait pour effet d’élargir le champ d’application du principe d’exception de la fraude et
d’entraîner encore plus de refus de paiement par le banquier qui pourrait facilement invoquer
la fraude, et de compromettre par conséquent l’efficacité et la rapidité du crédit documentaire.
S’agissant du premier et du troisième cas de figure, c’est-à-dire le bénéficiaire contrefaisait ou
falsifiait des documents ou présentant des documents dont il savait qu’ils sont faux dès
l’origine ; et le bénéficiaire, avec la collusion du donneur d’ordre ou d’un tiers, présentant de
faux documents sans aucune transaction réelle, on peut constater que ce sont les fraudes les
plus courantes dans la pratique, et qui sont relativement faciles à établir.
Toutefois, ce qui soulève le plus de problème est bien le deuxième cas de figure dans lequel le
bénéficiaire de mauvaise foi ne délivre pas la marchandise ou délivre la marchandise
dépourvue de toute valeur. Ici, la frontière existant entre la mauvaise exécution d’un contrat
commercial et la fraude pourrait soulever des difficultés d’appréciation. A fortiori, la
mauvaise foi du bénéficiaire est parfois difficile à démontrer. Dans un arrêt de Cour d’appel
de Tianjing le 28 novembre 2006, la Cour a retenu la responsabilité de la banque émettrice
invoquant la fraude dans les circonstances où le vendeur a délivré, à la place d’une certaine
plante médicinale sèche, la plante médicinale fraîche qui a pourri lors de son transport de
Chine en Corée, au motif que la plante fraîche correspondait tout à fait à la stipulation du
crédit documentaire qui n’a pas précisé l’état devrait être cette plante.
Il convient toutefois de noter que dans cette affaire, la mauvaise foi du vendeur aurait pu être
établie du fait que la plante fraîche n’a pratiquement pas d’effet médicinal et que le
bénéficiaire aurait dû anticiper le pourrissement possible pendant le long transport.
Quant au dernier alinéa, il regroupe toutes les autres fraudes n’ayant pas été prévues par les
trois cas de figure, ce qui laisse une large marge d’appréciation aux tribunaux. Il en ressort
que les actes qui pourraient être qualifiés de fraude ne paraissent pas bien délimités par le
Règlement et par conséquent, l’application du principe d’exception de la fraude soulève
souvent beaucoup de difficultés, l’incertitude juridique subsistant.
L’article 9 du Règlement prévoit que la fraude prévue dans l’article 8 autorise aux banquiers
et au donneur d’ordre à demander à la Cour la suspension du paiement du crédit
documentaire. Ainsi, elle prive le bénéficiaire de ses droits au titre du crédit documentaire et
exonère la responsabilité du banquier réalisateur, que ce soit une banque émettrice,
confirmante, désignée ou négociatrice.
L’article 10 précise encore que dès lors que la fraude est constatée par la Cour, celle-ci doit prononcer la suspension ou la cessation du paiement du crédit documentaire, sauf dans les cas suivants lorsque :
Il est donc considéré que le banquier émetteur ou confirmant est tenu de rembourser la banque
intermédiaire autorisée à réaliser le crédit documentaire si cette banque a régulièrement
réalisé, avant la découverte de la fraude, le crédit au vu de documents conformes en apparence
aux stipulations du crédit documentaire.
La fraude ouvre en conséquence un recours au banquier qui a payé le crédit documentaire et
ce, même si le banquier a commis une faute dans la vérification des documents et a payé le
crédit documentaire sans aucune réserve dès lors qu’elle n’a pas découvert la fraude avant le
paiement et était ainsi de bonne foi. Toutefois, ce qui est bien regrettable est que le texte ne
prévoit pas les cas des crédits documentaires payables à terme où la banque intermédiaire
avait payé le bénéficiaire par anticipation par rapport à la date convenue pour la réalisation du
crédit documentaire. Il convient donc d’ajouter à ce texte que le banquier qui anticipe la
réalisation du crédit documentaire le fait à ses risques et périls.
Dans le même ordre d’idée, le donneur d’ordre devra rembourser le banquier émetteur qui a
levé des documents « faux » dès lors que rien ne permettait de suspecter leur authenticité. Se
pose la question de savoir lorsque le donneur d’ordre se prévaut d’une fraude affectant les
documents d’un crédit documentaire afin de paralyser le paiement par la banque : est-ce que
la banque a obligation de refuser le paiement ? Le Règlement ne nous donnant pas de réponse,
les décisions des tribunaux sont partagées sur ce point.
***
Le Règlement de la Cour Suprême sur quelques questions concernant les litiges portant sur le
crédit documentaire fournit incontestablement aux tribunaux plus de précision et de certitude
pour statuer sur les litiges relatifs aux crédits documentaires. Néanmoins, on doit admettre
qu’il est loin d’être complet et que les RUU dans sa version actuelle reste toujours une source
de droit très importante pour les tribunaux chinois, et les jurisprudences importantes
étrangères ont également une influence considérable.
(1) Harbottle R.D. (Mercantile) Ltd. V. National Westminster Bank Ltd., (1978) Q.B. 146, (1977), 2 All. E.R.862,3 W.L.R.752.
(2) Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire : Litec 2005, 6e éd., p. 403.
(3) J. Stoufflet, Le crédit documentaire : Litec 1957.
(4) J.-P. Mattout, Droit bancaire international : Banque 2004, 3e éd., p. 259.
(5) J. Stoufflet, L’oeuvre normative de la Chambre de commerce internationale dans le domaine bancaire, in Études offertes à Berthold Goldman : Litec, 1987, p. 364 et s.
(6) RUU 500, art. 8
(7) G. Affaki, op. cit., n° 139.
(8) G. Affaki et J. Stoufflet : Banque et Droit, 2004, n°95, P62, obs.
(9) Cass.com. 4 mars 1953, S.1954-1-121, note Lescot
(10) M. Vasseur, note Cass.com. 7 avril 1987, D.S. 1987, p399
Kenneth WEISSBERG, Avocat à la Cour de Paris ; avec le concours de Xing HU, Diplômée de l’Université de Xiamen (Chine) et des Universités Paris X et Paris II
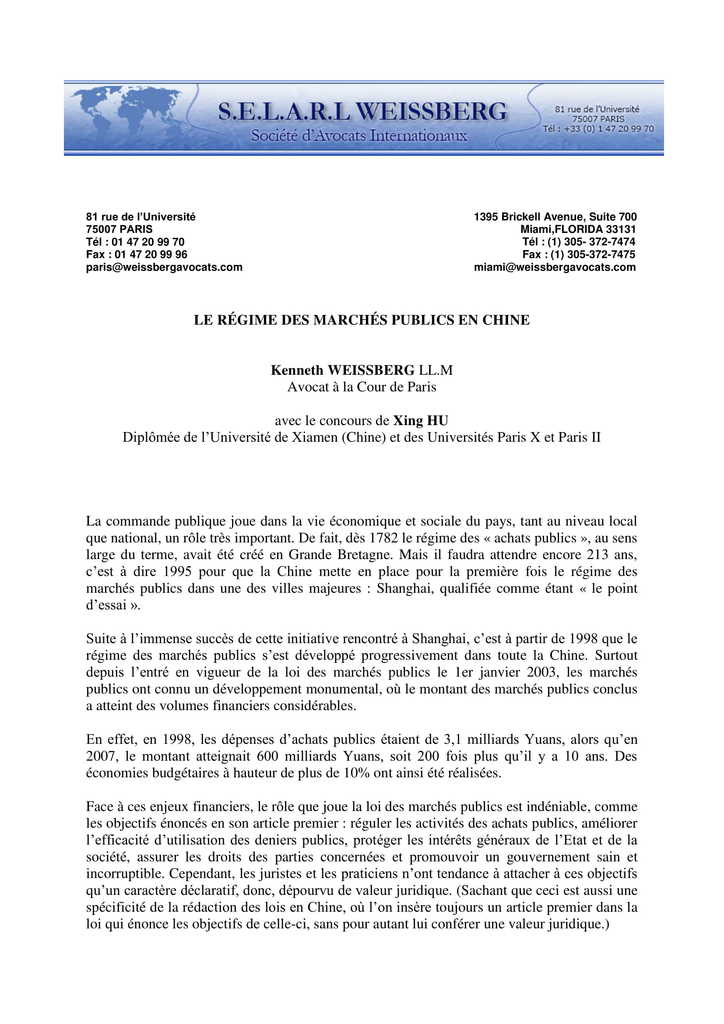
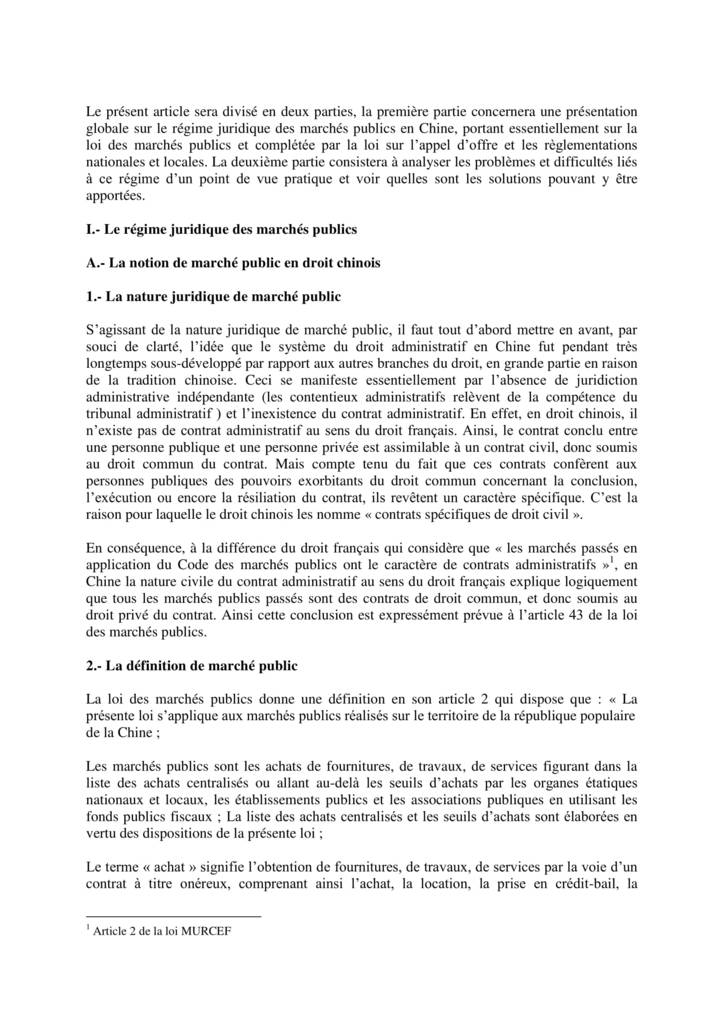
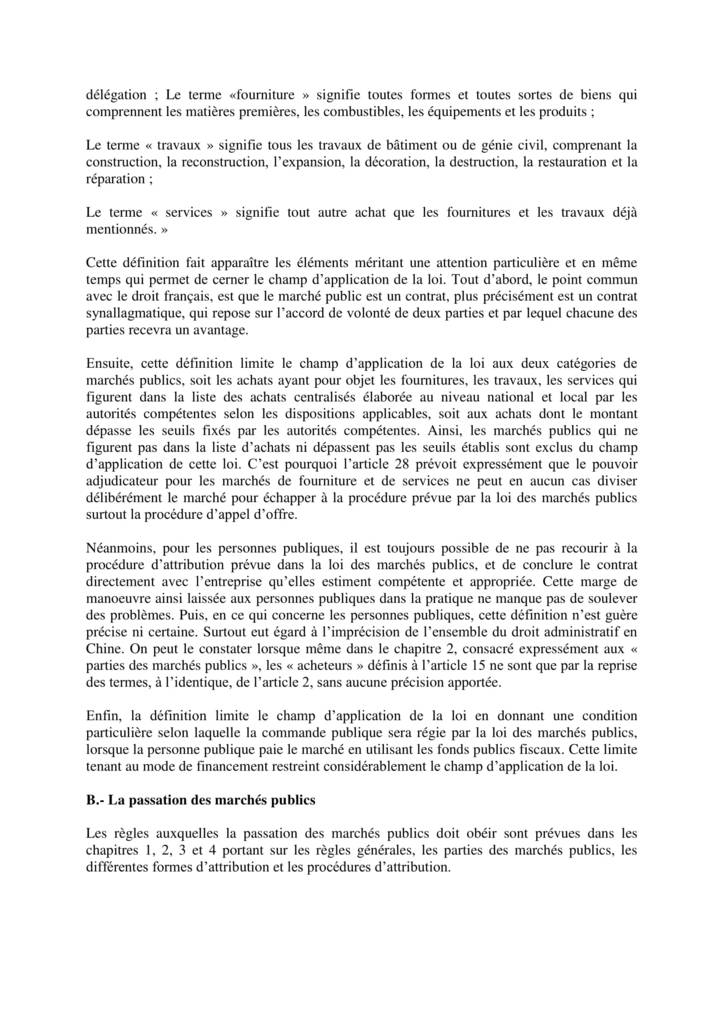
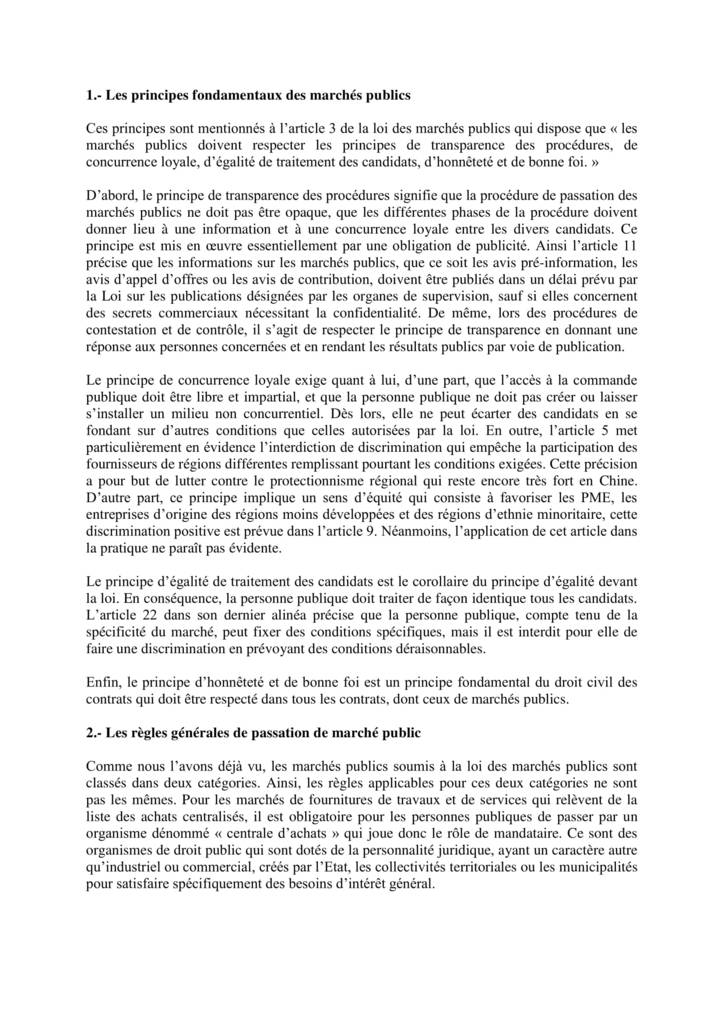

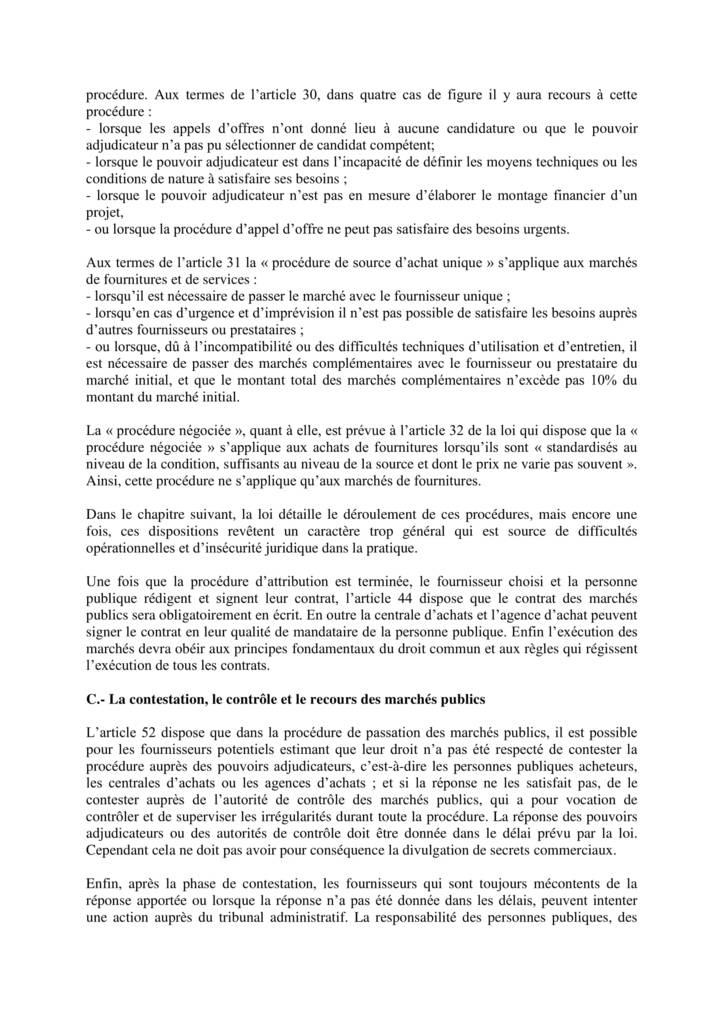
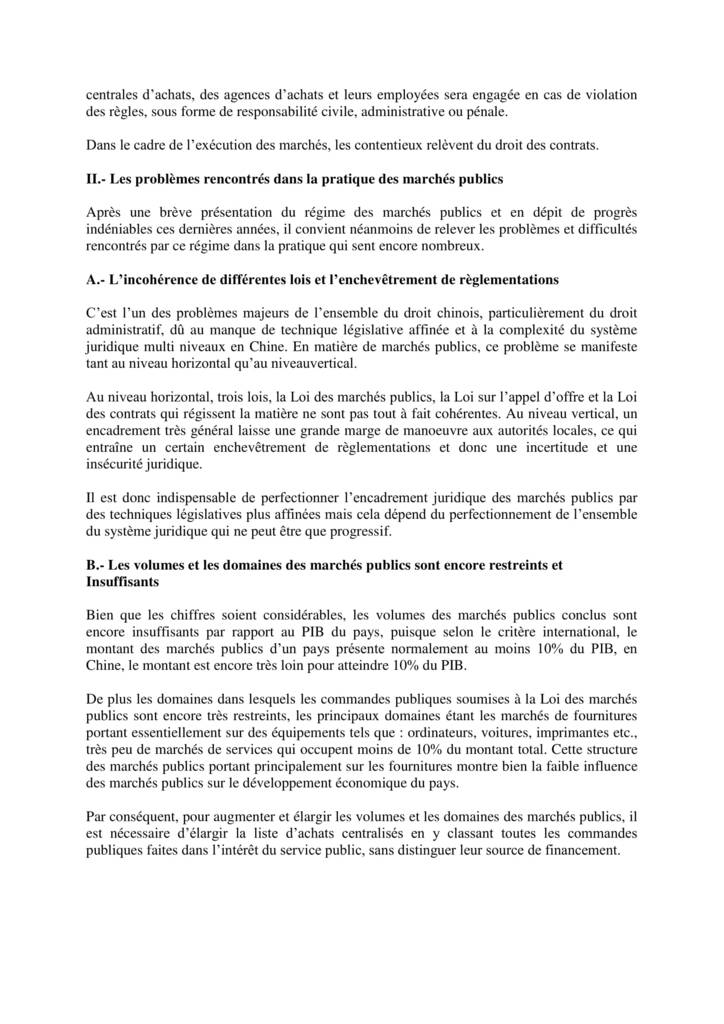
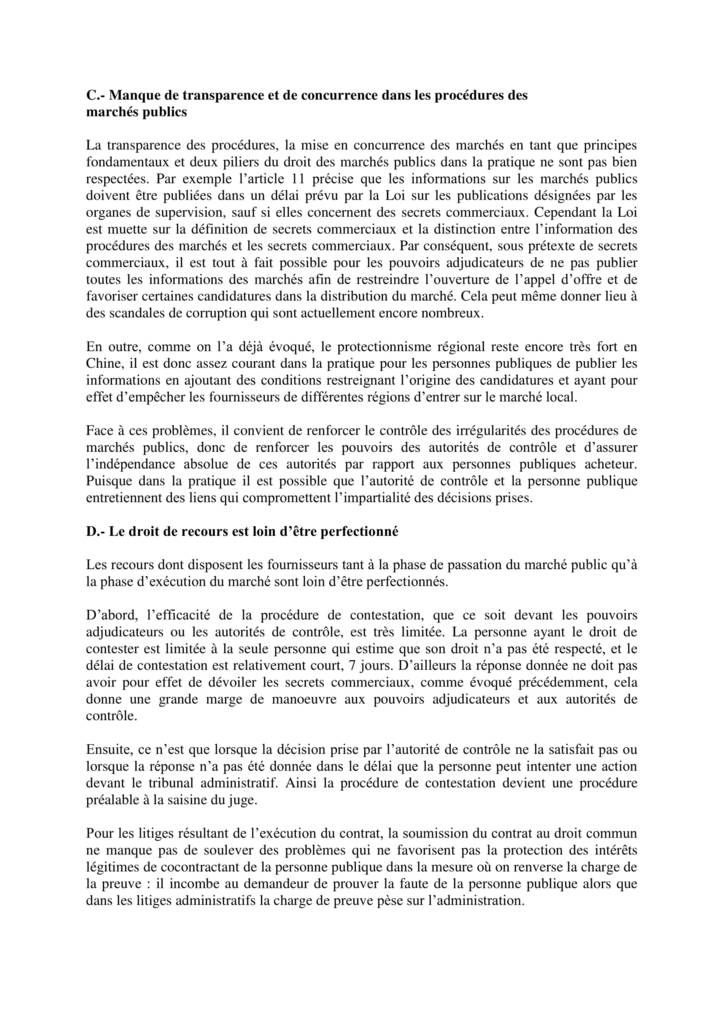
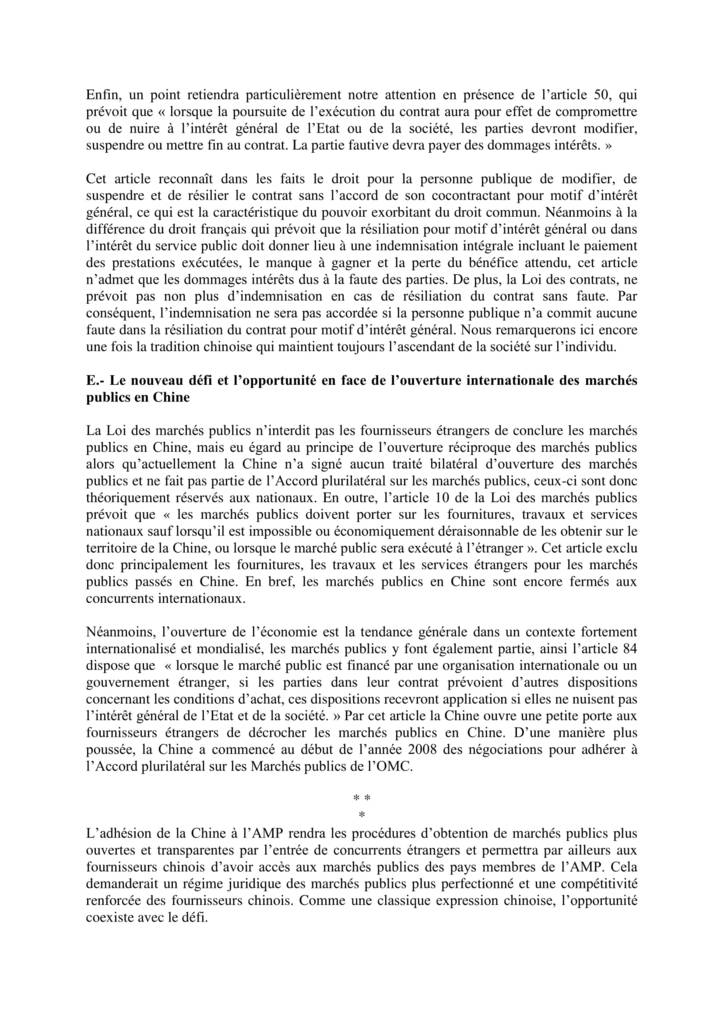
Après plus de trente ans de préparation, le projet d’une Société Européenne (SE) a enfin vu le jour grâce à deux textes, à savoir le Règlement (CE) n° 2157/2001 relatif au statut de la Société Européenne (ci¬après le « Règlement ») ainsi que la Directive 2001/86/CE complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (ci-après la « Directive »), tous les deux datant du 8 octobre 2001.
Le Règlement est entré en vigueur le 8 octobre 2004, et les Etats membres de l’Union Européenne auraient du adopter à cette date les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive, ces deux textes indissociables étant appelés à s’appliquer de façon concomitante.
Le projet très ambitieux du départ, visant à harmoniser les législations nationales et à créer des normes d’un nouveau type uniforme de société fut successivement abandonné en raison des trop grandes divergences entre les systèmes juridiques des Etats membres.
Qu’en est-il vraiment ? Quel est l’intérêt de cette nouvelle forme juridique ? Comment sera t-elle mise en œuvre ?
Le Règlement portant statut de la SE se résume à une formule juridique nouvelle et facultative qui s’adosse étroitement, mais avec une certaine souplesse, sur les règles déjà applicables, dans chaque Etat membre, aux sociétés anonymes.
De ce fait, la SE fournit un cadre pouvant être adapté conventionnellement et sur lequel peuvent jouer les normes des vingt-cinq systèmes juridiques des Etats membres.
Par conséquent, si la SE est de droit communautaire, c’est le droit de l’Etat où se trouve son siège social et son administration centrale (correspondant au siège effectif et réel de la direction) qui s’appliquera dans tous les domaines non régis par le Règlement, la Directive ou ses statuts.
Ce droit local sera notamment déterminant pour toutes les modalités de la constitution. A l’heure actuelle, la grande majorité de la doctrine semble écarter la possibilité de constituer « ex nihilo » une SE par des investisseurs souscrivant directement à son capital. Restent donc les quatre modes de constitution suivants :
(a) la constitution par voie de fusion, réservée aux sociétés anonymes d’Etats membres différents,
(b) la constitution par création d’une société holding, ouverte aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée ayant une présence communautaire à travers ses filiales ou succursales,
(c) la constitution sous forme de filiale commune, réservée aux entités de droit public ou privé si deux d’entre elles relèvent du droit d’Etats membres différents ou ont, depuis au moins deux ans, une filiale ou un simple établissement relevant du droit d’un autre Etat membre,
(d) par transformation d’une société anonyme en SE, à condition que celle-ci ait une filiale dans un autre Etat membre.
Toute constitution nécessite la rédaction des statuts, comportant les mentions nécessaires dans toute société anonyme de l’Etat membre dans lequel la SE aura son siège statutaire et son administration centrale, et un capital social d’un montant minimal de 120.000 euros.
Ainsi, il serait possible d’avoir une SE immatriculée en France faisant appel à l’épargne public avec un capital social de 120.000 € seulement, alors que le minimum que prévoit le Code de commerce pour les sociétés anonymes dans ce cas est de 225.000 €. Les statuts décident librement si la SE aura un système à conseil d’administration ou dualiste, l’Etat ne pouvant pas imposer son système. Il est probable que lorsque des représentants des salariés seront appelés à siéger dans les organes de gestion ou direction, on optera plus facilement pour un système dualiste, les laissant entrer dans le Conseil de surveillance plutôt que dans le Conseil d’administration.
Par ailleurs, la marge de liberté des rédacteurs est la même que celle pour l’établissement des statuts d’une société anonyme ordinaire ayant son siège dans l’Etat membre concerné. Il est à noter que des différences considérables existent à cet égard entre les divers Etats membres (le Royaume-Uni et l’Irlande laissant par exemple une grande liberté contractuelle, alors qu’il y a d’autres Etats, comme l’Allemagne partant du principe que « tout ce qui n’est pas expressément autorisé est interdit »).
Sauf dans le cas de la constitution d’une filiale sous forme de SE, l’immatriculation selon la législation de l’Etat membre ou est situé le siège statutaire, qui marque le point de départ de la personnalité juridique de la SE, doit obligatoirement être précédée d’une négociation avec les représentants des salariés des sociétés concernées quant à leur implication, à savoir leur information, leur consultation, voire leur participation dans les organes de gestion ou direction de la société, le but étant de préserver les droits acquis avant la constitution.
A cet égard, dès que possible après publication du projet de constitution, les négociations doivent être engagées au sein d’un « Groupe Spécial de Négociation » (GSN), spécialement constitué à cette fin selon des règles prévues par la Directive, lui assurant une représentation proportionnelle du nombre de salariés concernés dans chaque Etat membre. Grand nombre de détails par rapport aux modalités de nomination de ses membres, leur statut seront réglés par le droit national, autrement dit les lois de transposition de la Directive.
Trois possibilités s’ouvrent alors, en fonction du résultat de ces négociations :
• soit le GSN aboutit à un accord,
• soit il a décidé (avec la majorité qualifiée des 2/3 de ses membres, représentant au moins les 2/3 des travailleurs, ce chiffre incluant les voix de membres représentant des travailleurs employés dans au moins deux Etats membres) de ne pas entamer des négociations sur ce point ou de clore les négociations ouvertes et d’appliquer la réglementation relative à l’information et la consultation applicable dans chaque Etat membre où la SE emploie des salariés,
• soit enfin à l’issue de la période de négociation de six mois prévue par la Directive, prorogeable d’une durée équivalente, aucun accord n’a pu être conclu.
Dans ce dernier cas seulement, les dispositions de référence prévues par la Directive s’appliqueront impérativement dès lors que l’immatriculation de la SE est mise en oeuvre.
Par contre, si la SE est constituée par transformation, ces dispositions ne s’appliquent que si les règles d’un Etat membre relatives à la participation des travailleurs dans l’organe d’administration ou de surveillance étaient déjà en vigueur dans la société transformée en SE.
Dans les trois autres hypothèses de constitution, ces règles ne jouent que si, avant l’immatriculation de la SE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs sociétés ayant directement participé à l’opération en couvrant au moins 25 % du nombre total de l’effectif de l’ensemble de ces dernières (50 % en cas de SE holding ou filiale) ; si le nombre total de l’effectif reste en dessous de ces seuils, il faut une décision du GSN pour rendre les dispositions de référence de la Directive applicables.
a) Organe de consultation
A minima, ces dispositions de référence prévoient la création d’un seul organe de « consultation » dans l’Etat membre où la future SE est immatriculée et dans lequel les représentants du personnel ont vocation à siéger seuls. Ses membres sont élus ou désignés (selon les règles fixées dans la loi de transposition de l’Etat membre où la SE est immatriculée) en proportion du nombre de travailleurs employés par les sociétés participantes, leurs filiales ou établissements concernés. Est alloué à chaque Etat un siège par tranche de travailleurs qui y sont employés représentant 10 % du nombre de travailleurs employés dans l’ensemble des Etats de l’Union ou une fraction de ladite tranche.
L’organe de consultation a le droit de rencontrer l’organe compétent de la SE (conseil d’administration, directoire) au moins une fois par an, sur la base de rapports réguliers établis par ce dernier, afin d’être informé et consulté au sujet de l’évolution des activités de la SE et de ses perspectives.
Ces réunions portent notamment sur la structure, la situation économique et financière, l’évolution probable des activités, de la production et des ventes, la situation et l’évolution probable de l’emploi, les investissements, les changements substantiels concernant l’organisation, l’introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, les réductions de capacité ou les fermetures d’entreprises, d’établissements ou de parties importantes de ceux-ci et les licenciements collectifs.
De plus, lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles affectant considérablement les intérêts des employés, notamment en cas de délocalisation, de transferts, de fermeture d’entreprises ou d’établissements ou de licenciements collectifs, l’organe de consultation a le droit d’en être informé et de rencontrer l’organe de direction de la SE, sans disposer d’un droit de veto et en ayant une obligation de confidentialité.
En résumé, les fonctions et pouvoirs de cet organe de consultation ne diffèrent pas beaucoup de ceux que le droit français reconnaît aux comités d’entreprise.
b) Participation des salariés aux organes d’administration ou de surveillance
Il en est autrement pour la participation des travailleurs, véritable « exception culturelle » allemande, mais qui ne s’impose dès lors qu’en cas d’une implication d’une société allemande dans laquelle les règles de la « Mitbestimmung » (co-gestion) trouvaient déjà application avant l’immatriculation de la SE qui en résulte (essentiellement les sociétés anonymes de droit allemand avec plus de 500 employés).
Si aucune des sociétés participantes n’était régie par des règles de participation avant l’immatriculation de la SE, elle n’est pas tenue d’instaurer des dispositions en matière de participation des travailleurs.
On peut en définitive retenir que dans de nombreux cas, la SE peut être constituée sans participation des salariés aux organes d’administration ou de surveillance de la SE. En effet, l’accord qui doit être trouvé n’a pas forcément pour objectif la mise en place d’une participation des salariés, et le dispositif communautaire laisse à cet égard une marge de manœuvre considérable aux entreprises, toutefois au prix d’une réglementation complexe.
a) Fusions transfrontalières
Les principaux atouts prêtés à la SE tiennent à sa mobilité au sein de l’Union Européenne. Son siège social peut être transféré tout en maintenant la personnalité juridique de la société. Son adoption pourra permettre une simplification des structures d’administration des sociétés et contribuerait à une réduction des coûts.
Pour la France, le principal intérêt est probablement que le Règlement fournit un dispositif pour les fusions transfrontalières, opération que le droit français n’interdit pas, mais qu’il ignore jusqu’à présent.
Le Règlement met à disposition un cadre qui permettrait de fusionner assez facilement deux entités même en dehors d’un contexte mère-fille. Toutefois, en raison du numerus clausus des formes juridiques éligibles (notamment la Société par Actions Simplifiée n’en fait pas partie !), l’opération peut nécessiter une transformation préalable.
b) « Forum shopping »
Dans l’état actuel des choses, la forme juridique de la SE ressemble plus à un chantier qu’à un « produit fini ». Afin de permettre enfin son adoption, il a été délibérément omis de prévoir des dispositions spécifiques dans les domaines de la fiscalité, de la concurrence, de la propriété intellectuelle ou de l’insolvabilité.
A défaut d’harmonisation communautaire, c’est donc le droit de l’Etat membre dans lequel la SE a son siège qui a vocation à être appliqué et qui peut être plus ou moins contraignant.
Le choix de l’état d’implantation mérite par conséquent une recherche approfondie par rapport à l’environnement juridique, social et fiscal des pays susceptibles d’accueillir la SE, afin de pouvoir profiter des opportunités qu’offrent les différences significatives subsistant entre les Etats membres de l’Union Européenne à cet égard.
Ce genre de « forum shopping » est régulièrement hors de portée des sociétés qui ne sont pas déjà de véritables acteurs européens et habituées à manier des systèmes juridiques différents.
Les autres découvriront rapidement les attraits du Royaume-Uni et l’Irlande pour leur grande flexibilité au niveau des règles du droit des sociétés, le faible coût de l’immatriculation et leur faible taux d’imposition des entreprises et l’Espagne pour sa quasi-absence de règles imposant une implication des employés dans les affaires de l’entreprise. En revanche, l’Allemagne, avec sa co-gestion obligatoire, raison principale pour le faible taux de grèves dans le pays, risque de paraître complexe pour les investisseurs étrangers. Exemple : le groupe Airbus, dont on pourrait penser qu’il soit prédestiné pour s’organiser sous forme de SE et actuellement en phase de réorganisation, s’est déclaré ne pas être intéressé par cette forme juridique en raison des contraintes sociales, vu le grand nombre d’employés dont le groupe dispose en Allemagne.
La concurrence juridique et fiscale entre les Etats membres pour attirer les investisseurs est pleinement en cours. On trouve sur Internet des sites qui proposent des coquilles espagnoles ou anglaises « prêtes à l’emploi ». La réaction ne s’est pas fait attendre : à l’occasion d’un des derniers sommets, les gouvernements de la France et de l’Allemagne ont réclamé une accélération de l’harmonisation du droit fiscal au niveau communautaire pour contrer les effets dumping.
En ce sens, la SE est un parfait exemple de la dynamique propre à la plupart des textes communautaires, qu’on appelle aussi l’effet d’engrenage (« spill over effect ») : les lacunes laissées par les Etats membres lors de l’adoption se retrouveront comblées, par d’autres textes ou la jurisprudence de la Cour Européenne de Justice interprétant les texte à l’aide du fameux « effet utile ».
La France n’a pas encore transposé la Directive.
Deux projets de loi ont été élaborés jusqu’à présent : le projet Marini, qui se borne d’aménager le droit des sociétés, afin de mieux intégrer la nouvelle forme juridique de la SE et d’accroître la compétitivité des SE immatriculées en France, et le projet présenté par les sénateurs Branger et Hyest, qui englobe le volet social, autrement dit la transposition de la Directive.
a) Le projet Marini
Un point essentiel du projet du sénateur Marini est de vouloir conférer aux SE qui ne font pas appel public à l’épargne une souplesse dans l’aménagement des rapports entre actionnaires comparable à celle existant en France pour les SAS.
Par ailleurs, le projet tend à abolir les dispositions du Code de commerce imposant un nombre minimum d’actionnaires dans les sociétés anonymes et la nécessité pour les administrateurs ou membre du conseil de surveillance d’une société anonyme d’avoir la qualité d’actionnaire, permettant ainsi la constitution d’une SA unipersonnelle.
b) Le projet Branger/Hyest
Les sénateurs Branger et Hyest souhaitent également rendre les sociétés anonymes plus attractives en proposant la création d’une « société anonyme simplifiée » dans l’optique de prévoir une « passerelle » entre la SA et la SAS, par une procédure allégée de transformation permettant à la SAS, lorsque ses statuts sont compatibles avec les règles françaises issues de la transpositions des directives communautaires applicables aux sociétés anonymes, d’être considérée, par le biais d’une déclaration de conformité, comme une forme simplifiée de SA. Elles pourront ainsi prendre le nom de société anonyme simplifiée sans remettre en question ses statuts tout en évitant les contraintes liées aux transformations en sociétés anonymes.
Pour ce qui est de la transposition de la Directive, le projet propose d’intégrer un titre IX dans le livre IV du Code de travail, intitulé « De l’implication des salariés dans les affaires relatives à la société européenne ». Ses dispositions transposent la Directive et exercent les options qui y sont contenues pour respecter le dispositif d’implication des salariés en vigueur.
Fâcheuse tendance de la législation actuelle en France, le projet laisse un bon nombre de points à régler par le gouvernement par voie de décret, ce qui rend illusoire que dans un prochain temps, une SE pourra être immatriculée en France.
Les deux projets n’étant pas très éloignés l’un de l’autre en ce qui concerne les mesures envisagées pour l’aménagement du droit des sociétés, et le projet pour la transposition de la Directive restant sans surprise, il est assez probable que le résultat final sera une combinaison des deux.
A guide for business in Cameroon: Cameroon is a developing country located in Central Africa in which investment is considered as being the active seed which generates growth and development.